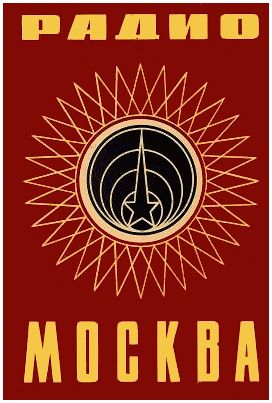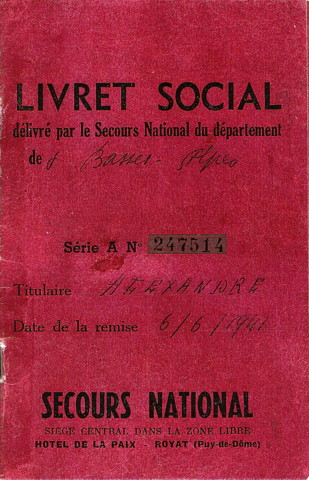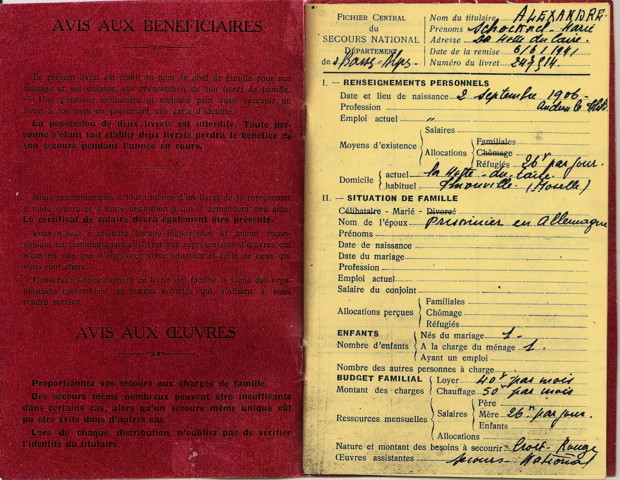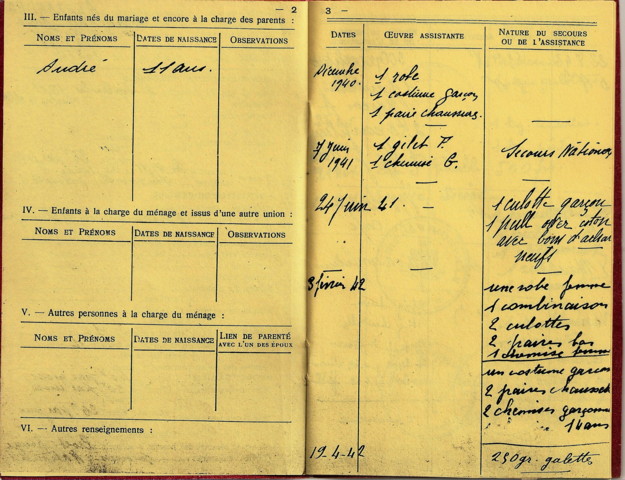André Alexandre, grandir en temps de guerre, de l'évacuation de Thionville à l'expulsion
André Alexandre[4] habite Thionville et il raconte ici l'évacuation de la ville avant l'arrivée des allemands puis son retour avant d'être expulsé avec sa mère en France libre. C'est l'histoire d'un petit garçon débrouillard et inventif qui apprend à tirer le meilleur parti de la vie dans les conditions les plus difficiles. André Alexandre n'a pourtant jamais eu le sentiment de crouler sous la catastrophe, il parle de sa chance, il s'agit en outre de son ouverture au monde et de sa curiosité insatiable de la vie. André a à peine dix ans, sa mère, de santé fragile, tient une épicerie et son père est prisonnier...
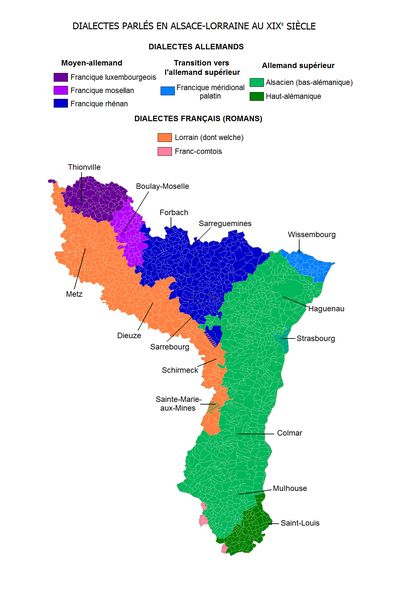
1939.
Je n'aime pas les allemands, je les déteste. Mon père m'a raconté, il sait très bien de quoi il parle: en 1914 il avait neuf ans comme moi et il était orphelin.
Son père venait de mourir dans un accident de travail, c'était la guerre et l'évacuation et il allait passer quatre ans de privations à Milli-la-Martine à travailler comme un homme.
RUMEUR DE GUERRE

Aujourd'hui mon père est inquiet[5]: il dit que l'Allemagne a signé un pacte de non agression avec la Russie alors que l'an passé, c'était avec la France et que les communistes ont perdu la cote d'amour. Il ne peut plus parler de ce qu'il sait, on lui répond « moi je ne fais pas de politique ». Il craint pour notre avenir.
Si les allemands nous envahissent il sera enfermé dans une forteresse de la ligne Maginot et il lui sera impossible de nous protéger. Il réfléchit au moyen de nous tirer de là au cas où et il achète une Simca cinq à crédit avec l'idée qu'elle nous permettra de nous sauver au bon moment.
Il écoute les nouvelles du monde entier sur un poste radio qu'il a commandé à paris dans une maison spécialisée. On n'en trouve pas ici: dix lampes, quatre gammes d'ondes courtes plus un réglage d'affinage, il est à sélectivité variable, il est antifading, il a un œil magique, il vaut le quart du prix de la voiture.
Mon père n'est pas plus rassuré pour autant. Les bulletins de l'étranger diffusés en français disent que nous sommes les plus forts: « notre puissance de feu, notre ligne Maginot, nos bases retranchées … Nous vaincrons »
RADIO MOSCOU
J'écoute radio Moscou, c'est très intéressant car leur micro est placé en extérieur et j'entends les bruits de la place rouge. On entend des voitures rouler et je suis étonné car ici on dit que les russes sont pauvres, qu'ils n'ont presque rien et surtout pas de voitures. Qui croire? Je ne comprends pas tous les mots des chroniqueurs, belligérants, plénipotentiaire.
Mon père a l'oreille collée au poste, il ne faut pas le déranger mais je demande quand même : « dis papa, prolétaire c'est la même chose que propriétaire? Et les belligérants, ils gardent les moutons? » Mon père hausse les épaules: "propriétaire et prolétaire c'est exactement le contraire!"
Il faut que j'arrête de poser des questions idiotes. Radio Stuttgart scande son slogan favori: « les anglais donnent leurs machines, les français donnent leurs poitrines. »
J'entends Big Ben carillonner à Westminster et les anglais chantent it's a long way to tipperary, it's a long way to you.... De l'autre côté de la frontière, notre voisin hargneux et belliqueux harangue le monde entier avec sa radio nationale, c'est le führer. Il a perdu la guerre de 14-18 et il n'accepte pas le poids des dommages de guerre que doit l'Allemagne aux vainqueurs de 18. Hitler a aussi sa conception personnelle des frontières de l'Europe: une vielle histoire l'oppose aux polonais, c'est une histoire de couloir et de dancing, il envahit la Pologne. Les polonais sont nos amis.
Il y en a plein qui travaillent dans nos usines en France pour faire les travaux les plus sales et les plus pénibles. D'ailleurs, mon meilleur copain est polonais. C'est Adam Boskiewicz, je trouve qu'il est plus intelligent, plus loyal et plus propre que mes copains italiens.
Je sais aussi tous les couplets de l’internationale. Les gens ne connaissent que le refrain et me demandent la partition complète: je fais mon cinéma en chantant sur un ton de confidence. Je hausse la voix pour le refrain, les deux poings serrés sur ma poitrine. On m'a défendu de chanter ça au magasin.
DÉCLARATION DE GUERRE

Donc la France déclare la guerre à l'Allemagne le deux septembre trente neuf et envoie l'infanterie à l'assaut. Mon père est mobilisé. Les troupes ne disposent que de quelques véhicules réquisitionnés et camouflés à la hâte. Les allemands ne réagissent même pas, c'est mauvais signe.
Ils ont parsemé la frontière de pièges à feu qui font plus de bruit que de mal et que les paysans d'ici utilisent aussi pour effrayer renards et sangliers.


Ces petits canons en fonte pèsent moins de deux kilo mesurent vingt centimètres la mise à feu est provoquée par la traction d'un petit fil tendu : on les commande à Manufrance. D'habitude on les charge à blanc, là c'est avec de la chevrotine. Les fantassins les appellent des pièges à con.
ENFERME DANS UN SAC

Ma grand-mère maternelle décède subitement. On la retrouve morte auprès de son loulou de Poméranie. On dit que c'est mieux pour elle. Que ça lui évitera les aléas d'une autre guerre. Son chien est bien triste. Il a peut-être deviné qu'il est de trop. Lorsque on doit se défaire d'une bête dont on ne veut plus il est d'usage de l'enfermer dans un sac avant de la jeter dans la Moselle. Un oncle se chargera de cette besogne.
Mon père parle beaucoup de cette guerre idiote en Espagne et du sort des enfants espagnols victimes du caudillo Franco. Les enfants de proscrits sont enfermés dans des camps, mal nourris brutalisés et obligé de travailler. La nuit, leurs geôliers s'amusent d'eux.
Il me regarde et dit « et celui-là, que va t-il devenir? Faut-il le mettre dans un sac et aller le jeter dans la Moselle?»
Ainsi tout doit finir si tôt et si mal. Je n'ai que neuf ans mais je sais que mon père a toujours raison. Ce n'est pas gai mais c'est la guerre. Je dois subir mon sort.
Je perds tout entrain, je maigris et je suis fatigué. Je ne parle presque pas. Mon père s'en aperçoit au cours d'une permission et à la permission suivante il revient avec la superbe bicyclette promise pour la distribution des prix du mois de juillet. Mais serai-je encore là en juillet?
Je remercie mon père mais je ne veux qu'une chose : apprendre à nager.
« Comment? Mais il fait bien trop froid pour aller nager en ce moment! » le ponton flottant sur la Moselle qu'on a appelé du grand nom de Thionville-plage est fermé en hiver mais moi, j'ai l'anxiété de finir dans un sac et je demande si les chiens savent nager.
Mon père comprend tout et me rassure enfin et pour s'excuser me dit qu'il va me prendre avec lui dans sa ligne Maginot. Il y connait une bonne cachette où il viendra partager chaque jour sa gamelle avec moi avec du pain et de l'eau : il n'y a pas de limonade pour les soldats.
LES FEMMES PRENNENT LA RELÈVE

A Thionville il n'y a presque plus d'hommes. Ils sont mobilisés.
Les femmes doivent accomplir les tâches de leurs maris. Celle du laitier, madame Brocli, doit livrer chaque jour les clients de son mari : de bien lourds bidons de lait à porter par temps de grand froid et de neige. La camionnette de livraison peine à démarrer, madame Brocli s'acharne à tourner la manivelle. Elle s'épuise. Elle prend froid et attrape une pneumonie. Elle meurt en quelques jours en laissant un petit garçon. Tout le monde est triste.
Les masques à gaz ont été distribués. Ils existent en trois tailles et les enfants doivent aller en classe avec leur masque dans une cartouche cylindrique portée en bandoulière. Rien n'est prévu pour les bébés.
Monsieur François le boulanger a été aussi mobilisé et c'est son beau père, Monsieur Hanstet qui reprends le fournil aidé de deux jeunes mitrons. Sa fille est partie s'abriter à Pagny sur Meuse car ses deux jumeaux n'ont pas de masque à gaz à leur taille. Le pain est bon et c'est ma mère qui se charge de le vendre dans son épicerie de l'avenue Albert 1er.
Les choses deviennent sérieuses: à Thionville le génie civil creuse des trous dans les piles du pont pour y placer des charges explosives.
Chaque nuit le ciel de la ville est balayé par un faisceau lumineux. Bien qu'on n'entende aucun avion, je sais que les allemands sont capables de tout et je me demande s'ils ne vont pas nous bombarder en traitres en se servant de planeurs silencieux. Je n'arrive pas à m'imaginer qu'en fait, ils sont à portée de canon.
La défense passive se met en place et désigne par un logo représentant une croix de Lorraine rouge sur fond blanc, les immeubles assez solides pour résister aux bombardements.
Un abri anti-aérien est creusé au bout de l'avenue Albert 1er à l'emplacement du futur l'immeuble Charlemagne.
Et une puissante sirène est installée sur le toit du lycée du même nom. Un coup long pour le début d'alerte, trois coups courts pour la fin d'alerte.
LA PIQURE

Le lycée Charlemagne est une école privée. Cela fait deux ans que je le fréquente et je vois les rangs de mes copains juifs s'éclaircir de jours en jours. J'ai un pressentiment. Je prends cette école en grippe: après tout, elle a été construite en 1912 par les allemands. Ses grandes portes, ses hautes fenêtres ne sont pas à une échelle normale, ce bâtiment est dangereux, je ne veux plus y séjourner. Ma mère cède et me fait entrer dans une petite école de la rue de la vieille porte à l'ambiance familiale, je préfère ça.

Vient le jour de la vaccination, la piqure de guerre, celle qui fait mal et qui oblige à rester à la maison le lendemain. Mon père l'a déjà eu dans sa ligne Maginot : un solide soldat a eu un malaise et s'est étalé de tout son long après la piqure. Sa tête a frappé une armoire métallique et le bruit a attiré tout le monde. Ils se sont moqués de lui...
C'est mon tour d'être vacciné, je sais que je vais passer en premier à cause de mon nom qui commence par A, les infirmières préparent leur matériel, l'eau bout dans une bassine en inox rectangulaire, on m'appelle, je me force à sourire...ouf j'ai tenu le coup, même pas mal, à vous les gars. On est des durs.
1940. LA DRÔLE DE GUERRE

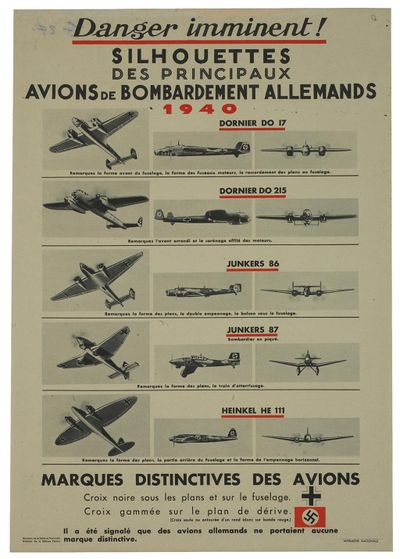
Des avions allemands font maintenant des incursions dans le ciel de la ville en plein jour. C'est pour nous effrayer et nous pousser à partir mais ça ne marche pas. Alors ils envoient des obus. Madame Falk est sur son balcon en curieuse avec sa petite fille dans les bras quand un obus éclate: elle est mortellement touchée et je vois la petite Danielle maculée du sang de sa mère mais indemne. La guerre tue.
L'évacuation de bêtes des fermes des environs est décrétée : c'est la pagaille en ville. L'avenue Albert 1er voit passer en flot serré les vaches affolées qui traversent la ville. Leurs veaux sont déjà partis pour l'abattoir et les pis des vaches sont enflés de lait: elles souffrent et marchent avec difficulté. je les entends meugler après leurs petits et pour avoir de l'eau.
Les chevaux glissent sur les pavés à cause de leurs fers. En voilà un qui s'est cassé la patte en tombant. Quelqu'un le couvre d'une couverture. Elle se soulève sous l'effet d'un pet. Un militaire s'approche pour achever l'animal. Un fardier de ramassage arrive, je me sauve.

Mon père nous fait sa dernière visite en bicyclette. Il vient du fort de Kobenbusch,[6] à douze kilomètres d'ici où les choses ont bien changé en une nuit. Il dit que les chefs autoritaires sont partis en catimini à bord de voitures de tourisme réquisitionnées. Les sous-offs ont pris la relève et la discipline est relâchée: les soldats font du farniente devant la porte du fort.
ÉVACUATION

C'est le 15 mai 1940 et c'est le tour des gens d'être évacués. Pour certains nous valons moins que des bêtes. Et si elle sont parties en premier c'est qu'elles, en cas de disette grave, on peut les manger et pas nous.
Ma mère n'a pas encore son permis de conduire donc pas de Simca. Nous rejoignons le convoi des prolétaires qui se rassemble place de la vieille porte. Nous n'emportons que ce que nous pouvons porter. Assis sur ma valise je regarde mon lycée détesté. Mes yeux lancent des bombes et je le vois s'écrouler en ruine. Autour de moi les bagages et les sacs de jute s'empilent, le grand-père Hanstet est là avec une hotte en osier sur le dos d'où dépassent les choses encombrantes qu'il a pris avec lui: c'est une bonne idée.
Par sécurité, le départ se fait de l'ancienne gare désaffectée de Beauregard dont les quais ont étés démonté en 1878. Les anciens ont bien du mal à grimper dans les wagons. Le train nous emmène d'abord à Metz où nous sommes hébergés dans le temple protestant qui se trouve entre les deux bras de la Moselle. Il est facile à surveiller et les accès rapidement condamnables. Des religieux nous visitent et nous donnent leur bénédiction et de petites médailles saintes.
Puis nous repartons de la gare de Metz après un contrôle méticuleux. Notre voisine, madame Bretnaker, est prise d'une crise de nerfs : elle crie, se débat et nous supplie de ne pas monter dans ce train. Elle dit que les voies sont minées et que nous allons tous mourir. L'équipe sanitaire s'occupe d'elle, la calme et la soutient pour monter dans le train. Le train démarre. Je ne sais pas où nous allons.
Les wagons sont très vieux: on monte directement dans chaque compartiment par une porte extérieure qui donne sur les deux banquettes. L'usage des toilettes est interdit à l'arrêt du train. Les sabots en fonte des freins font un tel barouf quand ils crissent avant l'arrêt qu'on ne risque pas de se tromper. Je regarde défiler les traverses de chemin de fer par le trou d'aisance.
C'est le début du mois de mai et il fait déjà chaud. Le train s'arrête souvent et longtemps pour laisser passer des trains prioritaires. Mais il doit éviter les gares en état d'alerte. Nous restons donc coincés des heures interminables sur des voies de garage où il n'y a rien à boire.
Les noms des gares sont masqués mais quelqu'un sait que nous allons vers Dijon: nous traversons d'immenses champs de colza en fleur, n'est-ce pas avec ça qu'on fait la moutarde? Autour de moi dans le wagon, personne ne sait.
RÉFUGIÉS A COLLONGE

À Dijon ma mère et moi arrivons exténués, des bus nous emmènent dans notre village d'accueil qui s'appelle Collonges les premières. Dans la cour de l'école, les gens sont là pour nous choisir et ma mère, malgré mes protestations, me débarbouille rapidement avec un mouchoir humide et tente de mettre de l'ordre dans mes cheveux bouclés. Je proteste que je ne vais pas à un concours d'élégance, je ne connais pas encore l'importance d'une bonne présentation.
Une dame sympathique s'avance vers nous, c'est la femme du chef de gare. Elle nous propose de partager les repas avec son mari et son fils et de dormir dans une mansarde meublée avec WC et lavabo sur le palier. Bien sûr nous acceptons. La gare est toute petite et j'ai déjà repéré une lapinière derrière: si on m'y autorise, je pourrais m'occuper des lapins.
Mais ma mère ne veut pas peser sur ces gens et elle trouve bientôt un cabanon de jardin aménagé que nous allons nettoyer tous les jours: il est inoccupé depuis longtemps et et envahis de mauvaises herbes.
La radio annonce la progression de l'ennemi. Tout recommence, les allemands avancent sans trêve et les gens d'ici sont terrorisés. Pour eux, les allemands sont des brutes sanguinaires et ils fuient tous en catastrophe.
Ma mère reste impassible, elle en a assez de ces pérégrinations qui ne sont pas sans danger et elle préfère rester et voir la suite des évènements. Même pas peur! On en a vu d'autres!
La famille du chef de gare est déjà partie, je le vois quand il saborde les armoires techniques, les connections électriques et le téléphone. Il nous confie sa maison. Il compte sur nos rudiments d'allemand pour empêcher le saccage de ses biens et me demande de continuer à prendre soins de ses lapins. Il nous donne libre accès à son garde-manger et cela nous aidera pendant l'exode.
Les poules et les lapins courent dans les rues désertes, les bêtes ont étés lâchées. Personne ne sera là pour les nourrir. Chaque fois que j'attrape un lapin je le mets dans la lapinière du chef de gare.
Les allemands sont arrivés, les gens de Collonges reviennent peu à peu. Le chef de gare se demande comment son cheptel de lapins a fait pour augmenter. Le boulanger est revenu aussi, nous avons du pain. Quelqu'un récupère une vache, un autre sait la traire, nous avons du lait.
J'avais espéré ne jamais revoir les allemands encore moins les côtoyer, je pense à la laitière et à la voisine, mortes toutes les deux, je pense à Verdun que j'ai visité.
Ils me donnent du chocolat et passent la main dans mes cheveux blonds. Ils sont gentils et je n'aime pas ça. Ils sont déçus que je ne parle pas allemand comme ma mère.
Une équipe de quatre hommes est venue réparer les installations électriques et téléphoniques détruites. Ils se déplacent sur les voies de chemin de fer en poussant un plateau monté sur boggies à l'aide de longues perches. Je demande s'ils ont besoin d'un coup de main et je suis fièrement nommé auxiliaire câbleur. Je suis chargé de préparer les petits straps d'interconnexion et de surveiller les gamelles : nous partons pour la journée.
RETOUR A THIONVILLE

La famille de ma marraine nous a rejoint à Collonges. Ils sont venus à bord du camion de l'entreprise familiale, ils sont couvreurs. Ils décident de rentrer et ma mère veut rentrer aussi pour sauver ce qui peut l'être.
Mais je m'en fous pas mal, je veux rester ici où on ne parle que le français, m'occuper des lapins et continuer à bricoler notre nouvelle maison.

J'ai beau implorer ma mère, je pleure, en vain. Je me sauve au moment d'embarquer mais rien n'y fait, les couvreurs m'ont pris à bras le corps et j'ai beau me cramponner, ils me balancent comme un sac par dessus la ridelle arrière du camion. C'est un camion si vieux que personne ne l'a réquisitionné!
Nous rentrons tassés à l'arrière du camion avec les provisions de lait.
Le voyage est long et pénible : il faut contourner les ponts qui ont sauté et les pneus du camion sont pleins et durs. Nous sommes tellement secoués qu'une petite boule de beurre s'est formée toute seule à la surface du lait. Nous sommes le 12 juillet 1940 et notre Odyssée a duré quarante deux jours.
Nous rentrons à la maison. Tout est intact ce qui n'est pas toujours le cas car les soldats de la ligne Maginot en déroute se sont livrés au pillage en se repliant. Ils cherchaient des choses de valeur légères à emporter: ils ont fait plus de dégâts que de profit.
Par contre l'épicerie de ma mère est pleine de souris. Je n'aurai pas du mettre Filou notre chat à la porte avant notre départ. J'essaie de l'appeler mais sans succès. J'espère qu'il n'est pas fâché pour toujours. En attendant j'installe toutes les tapettes à souris qu'il y a dans le magasin.
Un matin je trouve une souris prise au piège et juste à côté une petite souris minuscule et tremblante. J'essaie de la faire fuir en lui faisant peur, peine perdue, elle reste impassible. Je suis incapable de la tuer, il faudrait pourtant.
Mais je décide de la garder dans une petite boite en carton ouverte sur le dessus. Elle ne mange rien. Aucune autre souris ne lui viendra en aide.
C'est la guerre pour elle aussi: elle meure seule.
LE TEMPS DES RESTRICTIONS

Ma mère veut rouvrir son épicerie. Le stock est fortement endommagé et gâté et elle téléphone à son grossiste Mielle Cailloux à Metz. Leur camions de livraison ont étés réquisitionnes mais il y a des marchandises en stock et il nous faut trouver un transporteur pour venir nous approvisionner nous-même. Ma mère est en effervescence, aucune autre épicerie n'a réouvert, tout va recommencer comme avant grâce au camion de ma marraine! Maintenant il faut tout nettoyer.
Je lève le rideau de fer du magasin et déjà les gens se pressent contre la vitrine. Ils ne veulent pas attendre demain, ils sont déterminés à acheter tout ce qu'il pourront et en quantité. Le ton monte dans l'épicerie et ma mère me dit de baisser le rideau: les gens se calment et tout le monde finit par sortir : ils ne veulent pas d'histoire avec les autorités. Et ils n'ont pas tord car la gestapo, que tous craignent, arrive et veut savoir la raison du tapage. C'est la première fois que nous avons affaire à eux: ils parlent d'ordre nouveau et ils disent bien à ma mère que nul ne pourra s'y soustraire: je ne comprends rien.
Ma mère explique qu'elle n'y est pour rien, qu'elle va réapprovisionner le magasin demain, et qu'il y en aura pour tout le monde.
Le lendemain à Metz je vois des gens arrêtés dans la rue avec leurs enfants. Ce sont des familles juives et je pense en tremblant aux enfants espagnols dont me parlait mon père en 40. En voyant ça j'ai la gorge serrée et je suis glacé.
A Thionville, la synagogue est détruite par un incendie: les allemands empêchent les pompiers d'éteindre le feu, même les murs sont détruits à jamais. Ça me fait quelque chose, j'ai toujours admiré ce bâtiment: la synagogue était bien plus belle que notre église.
Notre église? je ne l'aimais pas avec sa façade imposante comme pour cacher la misère: un vrai trompe l’œil. Bref, quand j'étais tout petit, je voulais toujours aller à la synagogue avec mes petits copains juifs.
Mon père disait que c'était impossible, nous n'avions pas le même dieu et puis qu'ils me couperaient le zizi!
La belle affaire: il oubliait que je savais qu'on me l'avait opéré à la naissance par hygiène[7].
Mon père répondait:"tu sais eux, ils en coupent un peu plus". Cela me donnait à réfléchir car je ne voulais surtout pas de ça!

UNE BELLE HISTOIRE
Un soldat de la ligne Maginot passe à Thionville et nous apprend qu'il a été capturé avec mon père près de Rambervillers. Lui-même a été libéré de suite parce qu'il est né près de Thionville. Il dit que mon père est incarcéré dans l'ancienne caserne Gibon à Rambervillers et qu'il va être libéré bientôt.
Je me demande si les allemands libèrent les prisonniers par ordre alphabétique ou bien à l'envers. En tout cas ma mère décide d'aider mon père à tout prix. Elle parle allemand et pas lui : elle part pour Rambervillers. Je veux partir aussi bien sûr. Mais elle revient peinée de la gare: pas de train en service pour cette destination. Qu'importe! Elle ira en bicyclette.
Rambervillers est à 140 km d'ici mais ma mère irait sur les genoux tirer mon père des griffes des allemands. Elle fera autant d'étapes qu'il le faudra. Ma mère me confie quelques jours à madame Donval, une voisine et quand elle revient, elle a plein de choses à raconter. Pourquoi cette blessure au genou? Ce n'est rien , une chute à vélo.
Elle me raconte l'émotion des retrouvailles avec mon père, il va bien. Elle me raconte l'entrevue avec le commandant du camp et comment mon père a reçu la mission de récupérer les véhicules abandonnés ou endommagés faute de chauffeur allemand.
Il a donné sa parole de ne pas s'évader: a quoi bon prendre des risque alors qu'il va être libéré? Je suis émerveillé, ma mère est une vraie diplomate: elle a obtenu du commandant des permissions de sortie pour qu'elle puisse rencontrer mon père en privé.
Il doit comprendre que la guerre les a séparé plusieurs mois et il pousse la gentillesse jusqu'à laisser mon père utiliser les voitures récupérées pour faire des balades avec ma mère.
C'est une histoire que j'aime à raconter à tout va, mon père compte tant pour moi.

UN BÉRET FRANÇAIS
La vie reprends son cours malgré tout et je cherche un coiffeur qui pourrait couper mes cheveux : ils sont si longs que je ressemble à une fille et je suis obligé de les dissimuler dans un béret basque.
Je parcours les rues à la recherche d’une échoppe en tenant mon guidon d’une main. Un allemand en civil m’interpelle : il n’a pas l’air commode et en plus je ne comprends rien de ce qu’il me dit. Un passant traduit que je dois enlever mon béret, je ne le sais pas encore mais les allemands déteste le béret.
J'obéis et mon abondante chevelure blonde se répand aussitôt. L’allemand surpris, se calme et me fais dire avec le ton du maitre absolu que si on me reprend à rouler à bicyclette en tenant le guidon d’une seule main, on en coupera la moitié ! Il est fou lui ! Une bicyclette toute neuve ! Et en plus le dernier cadeau de mon père !

Dans les rue sans service d’ordre règne une bande de petits voyous venus d’on ne sait où. Ils s’introduisent dans les maisons pillées par les soldats français en déroute et récupèrent ce qui reste. Ils montrent fièrement leurs trophées, des poignards, des couteaux à cran d’arrêt, des cannes à bout ferré…
Quand ils me voient avec ma bicyclette ils m’arrêtent et tentent de me la prendre : mais malgré tous les sévices qu’ils m’appliquent je ne lâche pas prise et un grand s’approche qui m’enserre en les frottant les poignets cramponnés au guidon. Mais je préfèrerais me faire tuer plutôt que de lâcher ma bicyclette.
Ça brûle tellement que je crois que ma peau va se déchirer. Je crie si fort de ma voix aiguë de petit garçon qu’il me lâche. Je m’enfuis en vitesse mais ils ont eu le temps de crever un de mes pneus.
C’est le voisin, monsieur Willy qui répare ma bicyclette. Il est bien gentil. Il est menuisier et comme il est veuf depuis peu, ma mère m’envoie lui porter le surplus du repas quand il rentre le soir fatigué. C'est aussi lui qui va chercher le kamis-brot : aucune boulangerie n'a réouvert à Thionville et les allemands ont instalé un dépôt de pain rue du four banal. Le kamis-brot est un drôle de pain: il n'est pas blanc et ne doit pas contenir beaucoup de farine de blé ou de seigle... La première fois que j'ai été au pain, j'ai été pris de panique à la vue des soldats montant la garde et je n'ai même pas pris de pain. Monsieur Willy dit que les allemands ne sont pas méchants mais je sais ce qu'il en est depuis l'histoire du béret. Monsieur Willy est toujours content de me voir. Il commence par se laver les dents et viens m’embrasser sur les lèvres en jouant avec la langue. Je suis étonné alors monsieur Willy me dit que c’est comme ça que les russes disent bonjour.
Moi j’aime bien les russes, radio Moscou répète que les pauvres de tous les pays doivent s’unir pour empêcher les guerres ! Alors comme ça, ça va. Quand je raconte ça à ma mère, elle m’écoute sans rien dire. Puis l’air de rien, elle me dit qu’elle va me couper les cheveux elle-même…exécution immédiate !
C’est un massacre : ma mère a fait de son mieux et elle s’excuse mais sans ciseaux à dépaissir….Je fais semblant d’être contrarié mais intérieurement je ris : me voici affublé d’un bonnet en laine tricoté main. Je dis que je le porterai jusqu’à ce qu’un coiffeur me répare ! Ma mère rit avec moi contente de la modification de mon aspect physique : à partir de maintenant je porterai des pantalons longs !
Quand je revois monsieur Willy pour lui montrer comme je suis beau en pantalon long du dimanche avec ma chemise blanche et le nœud papillon bleu que ma mère a ajouté par coquetterie, il ne m’embrasse pas sur les lèvres et il me dit que maintenant que je suis un grand garçon, nous ne ferons plus de câlins : nous nous donnerons la main.
LA RAFLE

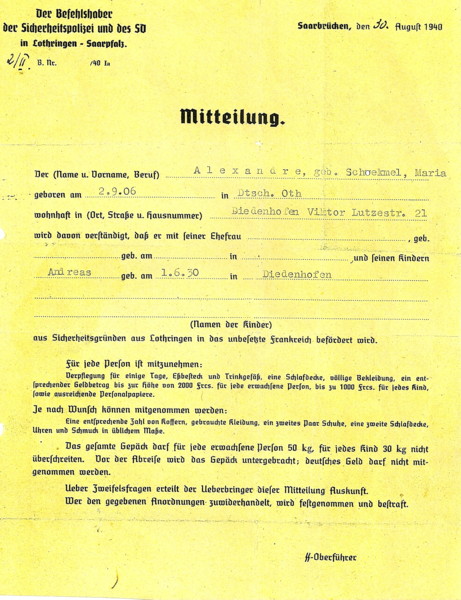
Le trente août 1940, très tôt le matin, deux soldats allemands en arme nous sortent du lit. Nous sommes des ennemis du Reich : nous sommes arrêtés pour être regroupés avec nos semblables.
Un des soldats allemands est un peu gêné, il est visiblement dérangé par mes yeux bleus et mes cheveux blonds filasses de mes dix ans à peine. Je l’entends dire à son compagnon en me désignant « schön Hitler jung » ce qui rajoute encore à mes craintes.
Un instant plus tard, son fusil, qu’il a laissé appuyé au mur de la cuisine, glisse et tombe sur le sol en mosaïque et rebondit dans un bruit métallique sinistre : son compagnon d’arme qui surveille ma mère dans une autre pièce pendant qu’elle emballe nos affaires, revient en trombe en vociférant comme s’il pouvait avoir peur de nous. Moi j’ai déjà visité Verdun, la tranchée des baïonnettes, l’ossuaire de Douaumont dans toute sa splendeur.
J’ai vu mourir une voisine que je connaissais bien d’un éclat d’obus allemand. Je viens de vivre l’évacuation, l’invasion, la défaite et le retour à Thionville. J’ai assisté à l’arrestation brutale de familles juives dans les rues de Metz. Je me demande si notre extermination est proche.
Mon père qui a été capturé à Rambervillers le 20 juin 1940 a refusé de devenir allemand et a donc renoncé à sa libération.
Ma mère a un malaise passager, je sais qu’elle est cardiaque et je finis de préparer nos affaires en jetant dans une valise ce que je pense nécessaire là où nous allons.
C’est réel: au bout de la rue le ramassage commence. En moins de dix minutes nous sommes propulsés dehors, embarqués et enfermés dans les camions. Nous traversons la ville en croisant le regard d’anciens amis matinaux qui nous ignorent prudemment.
l'ordre d'expulsion stipule que pour des raisons de sécurité, ma mère et moi devons être transférés en France inoccupée. Nous devons nous munir de nourriture pour plusieurs jours, un couvert et un verre, une couverture, des habits de laine et pas plus de 2000 francs par adulte et 1000 par enfant. Papiers d'identité et pas plus de 50 kilos de bagage par adulte, 30 par enfant. Interdit d'emporter de l'argent allemand et quiconque s'oppose aux instructions données sera arrêté et puni. Voilà le contenu de l'avis qu'on distribue aux gens destinés à être expulsés.
LE TRAIN

D’après ce qu’on entend, nous roulons vers Metz. Nous arrivons dans une petite gare dont j’ai oublié le nom. Un jeune homme que je connais de vue qui est je crois employé de mairie, il s’appelle Rossi, est roué de coups subitement là sur le quai par quatre soldats qui s’acharnent sur lui à coup de pieds après l’avoir jeté au sol en poussant des cris inhumains et sauvages.
Comme les autres, j’ai peur qu’ils ne l’exécutent devant nous comme ils nous le promettent en brandissant un pistolet menaçant. Rossi est trainé sans connaissance et en sang malgré les supplications de sa mère qui s’accroche au corps inerte de son fils.
Quand elle revient, égarée, elle ramasse encore la pipe, les lunettes brisées, elle ne sait plus ce qu’elle fait. Son fils ne parle pas l’allemand, il n’aurait pas compris assez vite qu’on lui ordonnait d’aider les gens handicapés à monter dans le wagon et cela a suffit pour qu’il soit rossé pour impolitesse et manque de respect à un soldat allemand.
Avec nous, blottie tout contre moi mon amie Yvonne Kaiser. Elle a connu comme moi les bombardements, la descente aux abris et l’évacuation et maintenant l’expulsion. Yvonne a perdu son père et sa mère est remariée : les allemands contrôlent les identités et comme Yvonne n’a plus le même nom que sa mère ils veulent la placer en orphelinat allemand le temps de consulter la famille de son père.
Yvonne et moi nous cramponnons ensemble en pleurant. Des expulsés s’interposent au risque de leur vie entre les allemands et nous et finalement les allemands renoncent à leur projet.
Ensuite on annonce que les sommes d’argent dépassant les deux mille francs autorisées seront confisquées ainsi que les titres et les bijoux.
Spontanément quelques personnes distribuent ce qu’ils ont en trop aux gens moins nantis avant d’avoir des histoires.
Le train démarre vers le sud, direction la ligne de démarcation qui sépare la France en deux. Le voyage n’en finit pas et dure plusieurs jours avec des arrêts la nuit sur des voies de garages loin de tout et aucun approvisionnement. Le train franchit au ralenti des ponts provisoires sans parapets et tangue bizarrement avec des bruits de roulage étranges. Je me demande sur quoi roule le train et si nous allons basculer dans le fleuve. Autour de moi on rigole « comme ça on n’aura plus soif ! ».
A un moment on nous ordonne de masquer toutes les ouvertures du wagon sur l’extérieur sous la menace des armes : sans le savoir nous passons la fameuse ligne de démarcation. Après toute ces gares qui nous séparaient de la France libre, nous arrivons à Chalons sur Saône, nous voilà débarrassés des allemands enfin : de ce côté de la ligne ils n’existent plus pour moi et tout le monde dans le wagon croit que nous ne les reverront plus : nous sommes bien contents.
Dans les gares suivantes notre croix rouge française est là. Les petits enfants sont ravitaillés en lait chaud sucré. Et nous recevons les soins nécessaires et boisson et nourriture.
DU PALAIS DE LA FOIRE A SISTERON

Enfin c’est l’arrivée à Lyon, la fin du voyage. Tout le monde est dirigé vers le Palais de la Foire. C’est là que se tiennent les foires expositions et nous arrivons dans les décors de la dernière exposition, les enseignes ne sont pas encore démontées et nous sommes répartis sur les stands en fonction de nos tickets d’entrée. Ma mère m’emmène à la recherche du stand « au berceau lorrain ». Dans le brouhaha ambiant les hauts parleurs lancent en flot continu leurs appels au regroupement des familles. Le séjour s’éternise et les enfants sont si turbulents qu’on ouvre des classes en pleines vacances scolaires : les organisateurs ont eu la bonne idée de distribuer les bons de repas pendant les cours : pas d’école, pas de soupe !

Un matin le haut parleur annonce que les expulsés sont invités à choisir eux-mêmes l’endroit en France où ils désirent s’établir parmi un certain nombre de villes. Ma mère en a assez de la vie au Palais de la Foire et choisit l’endroit qui correspond au premier départ sur la liste : Sisteron.
Mais à Sisteron rien n’a été prévu pour nous héberger. Un grand garage inutilisé est réquisitionné au dernier moment, on jette quelques bottes de paille au sol et voilà notre abri : plus de cent personnes qui dorment et mangent au même endroit avec un seul robinet d’eau potable et un petit canal de cinquante centimètres de large devant la gare toute proche pour se laver.
Ce n’est pas suffisant et rapidement, tous les enfants attrapent l’impétigo, une infection de la peau très contagieuse qui nous couvre de plaies purulentes de la tête aux pieds. Comme en plus il fait encore chaud, les mouches nous envahissent. Les gens du coin ne veulent pas voir leurs enfants contaminés et nous sommes exclus de l’école. Les adultes sont las et pleins de rancœur. Ils parlent d’«un pays de mouches de mistral et de courges ». Mais moi je l’aime bien ce pays, je le trouve apaisant.

Du définitif est annoncé : départ en autobus selon l’ordre alphabétique, Alexandre, pour nous c’est tout de suite. Nous allons à Château-Fort. Le nom de la mère d’Yvonne commence par Z pour Zimmerman et je ne saurai même pas la destination de leur bus. J’en ai vraiment marre maintenant : dans le bus où j’ai pris place je regarde Yvonne qui attend dehors. Je pleure en me demandant si nous nous reverrons un jour.

PREMIÈRE ÉTAPE EN PROVENCE
Châteaufort [8]est un village de montagne et les bus ne montent pas là haut. En tout cas le chauffeur ne connaît pas la région et cela explique sa témérité : les virages sont de plus en plus serrés sur ce chemin de montagne mais il continue jusqu’à rester bloqué en porte à faux, la plateforme arrière au dessus du vide : très loin au fond coule un torrent empierré qui s’appelle la Sasse[9]. La peur passée et tout le monde dehors, nous prenons un raccourci et bagages à la main, nous suivons le sentier, jusqu’en haut de la montagne et nous tombons sur une petite butte où les habitants nous attendent devant une petite église fermée. Quatre familles seulement dans ce village minuscule. Le maire âgé et sourd, a confondu au téléphone nombre de familles d’accueil et nombre d’habitants du village : nous sommes beaucoup trop nombreux.
Nous restons là sans rien dire à nous regarder plusieurs minutes sans parler : il faut dire que notre renommée nous précède et que certains parmi nous parlent encore allemand entre eux alors que les habitants parlent le patois local. Finalement nous nous rapprochons et nous sommes répartis pour la nuit dans les granges des fermes du village autour d’un seul point d’eau, la source. Ma mère est si épuisée qu’elle a un malaise important.
La femme du maire, madame Richaud lui tend un petit verre en lui recommandant de le boire d’un trait : c’est de la gnole et ma mère se précipite vers l’abreuvoir du cheval en reprenant bruyamment sa respiration. Ma mère ne boit jamais d’alcool et j’ai peur un instant qu’elle ne se jette dans l’eau pour calmer la brûlure de sa gorge en feu.
Ma mère se reprend et demande les toilettes. Elle s’absente longtemps et je m’inquiète mais elle revient sans avoir trouvé malgré les explications : et pour cause, les toilettes sont dans l’écurie, à côté des bêtes, sur le tas de fumier… Le docteur Tronc a été appelé. On m’a éloigné pendant qu’il l’ausculte et je vois la fermière me désigner du doigt sans parole. Je comprends que les nouvelles sont mauvaises.
Le docteur s’approche de moi et regarde mon impétigo[10]. Il dit que je suis contagieux et que je dois être isolé des autres enfants : lui-même ne m’a pas touché. Il regarde les médicaments qu’on m’a donnés à Lyon : eau d’Alibour et pommade de zinc et d’oxyde de mercure à badigeonner sur les plaies. C’est une pommade qu’on commande spécialement en pharmacie : elle est rouge orangée très vif et sans autre effet : elle attire les mouches et les taons. Le docteur me dit que le traitement est bon et de le continuer.
Pourtant j’ai le visage tout maquillé et flamboyant et je crois que rien ne peut enrayer mon mal, cela dure depuis trop longtemps. Mais je suis résigné et je pense que cet enduit orange trop visible sur ma face ne sert qu’à signaler mon état de contagion. Puis c’est le tour de Michelle Milani, une petite fille du groupe : le docteur l’examine car son irritation fessière ne régresse pas et que sa pauvre mère ne sait plus comment la soigner. Madame Milani est jeune et très déprimée.


Elle parle de se jeter dans le ravin avec le landau de sa fille. Ma mère la tient à l’œil car elle craint qu’elle n’exécute son funeste projet : c’est que les précipices ne manquent pas dans la région, il n’y a que l’embarras du choix. La fermière lui a laissé la chambre de sa fille qui est grande maintenant et peut quitter la ferme pour s’installer ailleurs. Madame Milani doit quand même faire bouillir l’eau qu’elle a été chercher à la fontaine dans une bassine : il n’y a pas d’eau à la ferme.
Ma mère, elle, ne peut pas faire de travaux lourds, de toute façon elle a une peur panique des bêtes. En revanche elle se propose pour faire du ravaudage et ça tombe bien il y a plein de linge à repriser. Nous nous installons dehors pour profiter de l’air, ma mère a besoin de respirer.
A proximité des blocs de pierre qui nous servent de banc un homme d’une bonne cinquantaine d’année se repose. Il m’intrigue avec le haut de son chapeau de paille décousu : ma mère propose de réparer le chapeau et m’envoie le chercher ce qui me permet d’approcher ce monsieur peu ordinaire tout en restant en retrait à cause de la contagion.
GABRIEL
Je pars en reconnaissance à l’orée du village mais je reviens en courant me blottir près de ma mère pour la prévenir qu’il y a des crocodiles dans ce pays chaud : en fait, je viens de croiser un très grand lézard vert qui fait bien une cinquantaine de centimètres de long.[11]
Le monsieur s’appelle Gabriel Massot, je lui montre en écartant les bras, la taille du crocodile qui court si vite et est parti se cacher : il me rassure en riant. C’est un lézard inoffensif mais moi je ne ris pas car je ne le crois pas. Je sais très bien ce qu’est un lézard, il y en a aussi chez nous à Thionville : ils sont gris et petits.
Quand on les attrape leur queues se détachent et restent dans la main en continuant à remuer.
Gabriel me demande comment nous sommes arrivés là et je lui raconte notre histoire : c’est facile car les émotions sont encore toutes fraiches en moi. Gabriel me raconte sa guerre à lui: il a été à Verdun.
Mon père m’a déjà emmené à Verdun dans sa voiture. Avec lui j’ai visité le fort de Vau, le chemin des dames, la tranchée des baïonnettes et l’ossuaire de Douaumont : j’ai vu les ossements des soldats morts. On peut les voir à travers des petites lucarnes vitrées, bien rangés et ficelés en fagots derrière les crânes posés devant.

Je dis à Gabriel que les allemands sont méchants, je raconte comment ils se sont mis à quatre pour rosser devant nous un jeune homme qui ne leur avait rien fait et comment ils l’ont emmené, dans les pommes pour continuer à le battre ailleurs. Peut-être même le fusiller.
Je lui dis aussi comment ils ont fait mon père prisonnier sans livrer bataille. Qu’ils sont passés en traitres par la Belgique et le Luxembourg pour contourner la ligne Maginot et que quand je serai grand je les tuerai tous !
Gabriel se tait. Il est ailleurs. Alors je dis que je ne tuerai que les méchants et que les autres allemands, je les ferai prisonniers : ils devront travailler sans avoir beaucoup à manger. Gabriel devient ainsi mon grand ami. Je recherche sa compagnie. Et j’en apprends sur lui !
Gabriel a été riche. Il a encore un ancien « Garage de Nibles » de l’époque où il était charron. Il a été blessé pendant sa guerre à lui. Il ne s’en est jamais remis. Il n’a plus jamais fait le charron dans son Garage de Nible.
Il est rentré de guerre brisé physiquement et moralement. Sa femme l’a quitté. Ses deux filles lui rendent rarement visite. Gabriel s’est installé dans une ancienne dépendance du château en ruine, une petite maison abandonnée où il vit de sa maigre pension d’invalide de guerre, de son petit jardin, de ses poules, et de ses lapins.

Pas d’eau dans les maisons du village. Chez Gabriel pas d’électricité non plus. Pourtant il a gardé de sa vie d’avant un poste radio avec quatre lampes sphériques sur le dessus. Elles brillent comme l’intérieur d’une bouteille thermos. A côté trône le majestueux pavillon du haut parleur en col de cygne. Mais sans accumulateur cette radio ne peut fonctionner.

Gabriel possède aussi un poste à galène muni de son lourd écouteur en bronze nickelé avec gravé sur le pourtour « propriété insaisissable de la compagnie de téléphone». Pour que ce téléphone marche il faudrait une grande antenne placée très haut : Gabriel n’a pas d’échelle.
Gabriel me fait visiter son garage. Tout est resté là intact, depuis 1914. La forge avec son grand soufflet de cuir, l’enclume et les outils, le « travail » à ferrer les chevaux, rien n’a bougé.
Sa vieille voiture m’intéresse. Ses lanternes avant et arrière sont reliées par des petits tuyaux en caoutchouc à un réservoir à acétylène. Mais sans carbure, impossible de voir fonctionner ces bec de gaz ambulants !
A la ferme comme je ne parle plus que de lui madame Richaud me raconte qu’elle l’a souvent invité autrefois. Mais Gabriel n’est jamais venu. Elle me dit d’un air entendu que si c’est moi qui lui demande, il viendra peut-être. C’est ce que je fais : Gabriel a abandonné son vieux chapeau et mis une cravate avec ce qu’il a pu rassembler de costume : il est superbe et je suis ému, il est à moi maintenant. Chemin faisant, je le tiens par la main et je le tutoie sans m’en apercevoir.
A la ferme une surprise nous attend : les ouvriers journaliers sont tous là pour fêter l’évènement avec nous. Nous sommes plus de dix autour de la table et je demande la permission d’être placé à côté de Gabriel. Je suis heureux et joyeux, c’est la première fois ici.
Je ne sais pas encore que nous allons être séparés prochainement. Car ma mère veut que j’aille à l’école en ville. Elle part donc prospecter à la Motte du Caire et rencontre le maire. Justement un logement réquisitionné pour une famille expulsée se libère. C’est une famille nombreuse et les enfants ont dévasté l’appartement et importunent les habitants du village. Le maire leur a trouvé une maison isolée à l’extérieur et le logement est vacant. Ma mère demande à le partager avec madame Milani et sa petite fille.
Gabriel m’invite chez lui pour un diner d’adieu. Il a bien fait les choses : repas gastronomique, lapin au menu. Sur la petite table où il mange quand il est seul il a disposé le poste à galène, son écouteur et une couronne de fil d’antenne[12]. Je sais tout de suite qu’il va me le donner. Mais je ne devine pas encore l’importance que ce cadeau aura pour moi.
Je n’ai rien à donner en échange à Gabriel mais je lui promets que les dix kilomètres qui vont nous séparer ne m’empêcheront pas de venir le voir souvent, à pied s’il le faut, cela ne me fait pas peur.

DEUXIÈME ÉTAPE, LA MOTTE DU CAIRE
A la Motte du Caire où nous avons emménagé avec madame Milani, nous sommes très bien logés : et nous avons l’eau courante à l’évier de la cuisine. La maison a un balcon dont les portes fenêtres donnent sur la montagne et tout au bout du balcon il y a un petit cabinet d’aisance extérieur pourvu d’eau courante également.
Ma mère et madame Milani s’entendent à merveille et partagent les tâches ménagères : j’ai ainsi une maman de secours et je suis rassuré pour la santé fragile de ma mère. Notre première sortie est pour le docteur Droit pour Michelle et pour moi : je veux guérir au plus vite de cette cochonnerie d’impétigo. Michelle que j’appelle ma Michounette chérie, ne doit pas attraper ma maladie.
Ma mère se débrouille pour tout: elle est toujours à l'affût de ce qui peut améliorer ma vie. Elle fabrique ainsi son propre savon d'après une recette récoltées auprès des villageois. Du lierre, de la graisse de mouton et de la soude contenue dans les cendres de feu de bois et un petit sac de lavande. Comme on cuit une soupe, elle chauffe le mélange sur le fourneau et le verse dans des moules disposés sur la table de la cuisine[13] . Je fabrique une petite croix de Lorraine en bois qui me sert à estampiller les savons encore mous tous juste démoulés: c'est le savon de la Motte du Caire!
Ma mère fabrique aussi des pantoufles avec le feutre récupéré de vieux chapeaux. Pour faire une semelle, il faut empiler plusieurs épaisseurs et les coudre ensemble. C'est assez dur et je me sers d'un pince pour pousser et tirer l'aiguille et percer le feutre. Un point de couture tous les centimètres, quel travail!

Mais ce n'est pas tout: ma mère détricote des vieux pulls de laine pour fabriquer chaussettes et gants sur mesure. Lorsque un habitant du village part à l'hôpital en urgence, les siens passent à la maison acheter chaussettes, pantoufles et savon de la Motte du Caire! En attendant que Michonette aille mieux, je la distrais en lui faisant des cocottes en papier, des bateaux et des avions aussi. Ce qui l’amuse le plus c’est l’oiseau qui bouge les ailes lorsqu’on lui tire la queue : c’est un pliage que j’ai appris auprès d’un handicapé pendant mon séjour au palais de la foire à Lyon. Je suis peut être aujourd’hui, le seul détenteur du secret de fabrication de ce pliage compliqué…
Depuis le balcon, j’ai repéré un grand peuplier en face de la maison. Pendant l’absence de mes deux mères, j’ai grimpé jusqu’à son sommet pour y installer l’antenne de mon poste à galène. Mais ma mère revient plus tôt et me surprend tout en haut de l’arbre. Elle est à la limite de la crise de nerf et me dit de ne plus recommencer ça, que je vais la faire mourir.

L’ENFANT DE CHŒUR
Je suis interdit d’école à cause de mon état contagieux et le curé s’empresse de faire ma connaissance. C’est un brave curé de quatre vingt quinze ans et il m’invite à suivre le catéchisme à l’église qui est moins stricte que l’école publique en matière de règles sanitaires, Deo Gracias !

Peut être pourrai-je être enfant de chœur me dit-il et en attendant il me faut prier pour mon père qui est loin de nous. Monsieur le curé me dit que Dieu entend toutes les prières puisqu’il entend déjà toute sorte d’autres choses…Je scrute le ciel en attente d’un message sur mon poste à galène mais celui-ci reste muet, sans doute étouffé par les montagnes environnantes.
Je demande au curé la durée qu’il faut d’habitude pour obtenir une bienveillance du ciel. Il me répond d’être patient et que Dieu a beaucoup de demandes à satisfaire. Il me dit aussi que le téléphone très particulier pour communiquer avec Dieu fonctionnera mieux quand je serai enfant de chœur. En attendant je collectionne les bons points que le curé confectionne lui-même dans des chutes de tapisseries, il n’est pas bien riche.
Au dos des bons points il écrit ses appréciations, je les ai encore dans mon livre de catéchisme.
Je deviens donc enfant de chœur et je dois servir la messe le dimanche à tour de rôle mais mes copains manquent souvent car leurs parents préfèrent qu’ils finissent le travail à la ferme et quand je vois le désarroi de mon curé devant le parvis désert de son église, je vais vers lui pour servir même si ce n’est pas mon tour.
L’instituteur que je ne connais pas encore perd son fils. Il est le seul enfant de l’école victime de la diphtérie. Je suis désigné pour servir la messe d’enterrement et je porte le goupillon en marchant vers le cimetière au côté du prêtre.
Au cimetière il faut maitriser l’instituteur, il est brisé de chagrin et veut se jeter sur la tombe de son fils. J’éclate en larmes pendant la cérémonie autant pour ce garçon que je ne connais pas que pour mon père qui est loin de moi. Je suis séparé de lui depuis si longtemps.



Cela fait six mois que nous n'avons pas de nouvelles de lui. S'il va bien, il doit être mort d’inquiétude car ses lettres ne peuvent que lui revenir avec la mention : PARTIS SANS LAISSER D'ADRESSE. En plus, il nous faudrait une de ses lettres pour l'adresse du stalag et pour le formulaire joint qui permettrait de lui répondre. Ma mère finit par dégotter le fameux formulaire et une amie lui transmet l'adresse. C'est notre première lettre, une façon pour ma mère de réunir ses deux Dédé puisque c'est ainsi qu'elle nous appelle mon père et moi. Les fautes d'orthographe, ma mère a été à l'école allemande en 14-18 et moi j'ai beaucoup manqué, ces fautes ne nous empêchent pas d'écrire le plus souvent possible. Ma mère mesure ma taille à chaque lettre. Je tiens une boite en carton sur la tête et quand je me retire ma mère marque la chambranle de la porte à la craie. "Tricheur! " je me suis mis sur la pointe des pieds...
N'empêche, quand j'entends Rina Ketty chanter "j'attendrai" à la radio, je cache mes yeux pleins de larmes.
Un dimanche que je sers la messe, mon curé s’affaisse lentement dans l’allée centrale de son église. Ses lèvres touchent le sol et je me demande si c’est un rite religieux inconnu de moi. Mais pourquoi ne m’aurait-il rien dit ?
En fait mon curé vient d’avoir un malaise cardiaque et il décède l’après-midi même. La Mathilde, sa servante, me fait venir au presbytère pour assister à l’extrême onction selon le vœu ardent de mon curé sur son lit de mort.
LA PRÉCARITÉ
Pour en finir avec mon impétigo je retourne voir le docteur Droit : je lui demande d’en venir à bout coûte que coûte. Il me dit que c’est possible si je suis assez courageux et volontaire. J’accepte et le docteur commence à décortiquer mon impétigo avec un certain raffinement dans la douleur. Il se sert d’une curette pour arriver à tout enlever et admire mon courage et ma résignation sous la torture.
Quand je sors de chez lui je suis devenu un héros volontaire de la guerre, bardé de bandage de la tête aux pieds, on m’appelle la Momie. Les mouches ne peuvent plus me tourmenter, quel soulagement ! Au village, maintenant que mes plaies sont cachées, on ne me regarde plus avec méfiance mais avec compassion.
Mais en revanche ce traitement à vif m’a fortement secoué : j’en ai attrapé une jaunisse, je suis jaune de partout et je vomis de la bile si acide qu’elle attaque le carrelage des escaliers où j’ai vomi. Je maigris beaucoup comme le montrent les photos d’école de cette époque : j’ai pris une tête de vieux. Je me lie d’amitié avec une petite fille expulsée, Victorine qui est encore plus maigre que moi au point qu’on dit qu’elle a la tuberculose. Ce n’est même pas vrai, elle est seulement gravement anémiée. Sur le banc où nous partageons notre sort de déscolarisés, je lui donne la moitié de mon quatre heure. Victorine est si maigre que madame Lagarde, une cultivatrice aisée s’engage à lui donner un œuf chaque jour si Victorine vient le chercher à la ferme.
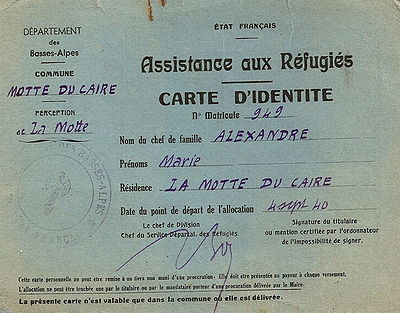
Monsieur Milani a franchi la ligne de démarcation : il a la chance d’être passé au travers du filet tendu par l’envahisseur. Il nous rejoint à la Motte du Caire pour trois jours. La petite Michonnette me préfère à lui et j’en suis très honoré.

Monsieur Milani trouve du travail à Cahors et avant de nous quitter, il fabrique pour moi un bâton comme en font les soldats désœuvrés dans les tranchées : une branche d’orme où il sculpte un serpent enroulé autour de la hampe et un pommeau en forme de tête de poilu casqué ornée de points brûles au fer rouge. Il me le laisse en riant pour combattre les sales crocodiles du coin. Les Milani s’en vont. Michonnette n’est plus là : quel vide, quelle tristesse dans la maison sans elle.
Nous nous retrouvons seuls et comme la santé de ma mère ne lui permet pas de prendre un emploi, l’épouse du maire rédige une attestation qui dit que ma mère femme de prisonnier de guerre et expulsée et mère de famille est de santé précaire. Précaire est un mot nouveau pour moi : il nous permet en tout cas de toucher l’allocation pleine et entière d’expulsés en plus de la solde des ayants droit des prisonniers de guerre.
Régulièrement, nous descendons ma mère et moi jusqu'au centre social de Sisteron pour nous ravitailler. Les montées sont si abruptes que nous passons les sommets à pied: il fait très chaud et nous sommes épuisés. Le long de la route étroite qui va de la Motte du Caire à Sisteron en passant par Nibles, nous avons l'habitude de faire une pause à l'ombre d'une grande aiguille rocheuse qui surplombe la route à près de cent mètres de hauteur. Ce rocher m'inquiète, j'ai peur qu'il s'écroule et je tanne ma mère pour que nous quittions cet endroit au plus vite.
Elle est très fatiguée et je l'agace: " ça suffit comme ça! à Thionville tu avais peur des bombardements, tu avais peur des allemands aussi et maintenant tu as peur de la montagne: elle ne va pas te tomber sur la tête, va! "
Il faut que je cesse d'être aussi craintif comme ça et pour donner le change à ma mère, je blague malicieusement en disant qu'au moins , je n'ai plus peur des crocodiles...Mais je n'en mène pas large, cette montagne reste une menace.
Au centre social, je lorgne vers les étagères chargées de lait concentré Nestlé, j'adore ça mais ici, elles sont réservées aux petits. Quand par chance ma mère parvient à en obtenir une, je la fait durer des jours en la dégustant, très lentement, à la petite cuillère. Dans la salle d'attente je lis des numéros périmés de "Lecture pour tous". C'est très instructif mais aussi très pénible: je tombe sur un article sur les massacres perpétrés par les turcs sur les kurdes où j'apprends qu'on a passé des femmes enceintes à la scie circulaire.[14] La nuit qui suit je fais des cauchemars épouvantables. Ma mère ne comprend pas ce qui m'arrive , j'allais pourtant beaucoup mieux ces temps-ci. Je me garde bien de lui dire d'où viennent les cauchemars, elle ne me prendrait plus avec elle à Sisteron.
RETOUR A ÉCOLE

Je suis enfin admis à l’école communale car mon impétigo s’est dissipé. Je revois mon instituteur, monsieur Hillaire: c'est lui qui a perdu un fils de mon âge qui, il parait, me ressemblait beaucoup . Je suis blond comme lui et j’ai les mêmes yeux bleus, ce qui n’est pas très répandu par ici même si ce n’est pas rare.
Le maitre d’école a promis à ma mère de me faire rattraper mon retard. Il est tellement désemparé depuis la mort de son fils qu’il a besoin d’une diversion. Il me retient donc après la classe. Il rapproche sa chaise de mon pupitre dès que nous sommes seuls et une fois les leçons terminées, nous parlons de tout ensemble « d’homme à homme ».
Géographie, ressources mondiales, sciences, mécanique, électricité photographie, nous parlons même de politique et nous ne voyons pas le temps passer. Nous sommes si bien ensembles que j’ai l’impression d’être au côté de mon père qui me manque tant. Afin de nous ramener aux réalités, madame Hillaire descend bientôt avec une tasse de lait et une tartine de confiture. C’est sa façon de nous faire comprendre qu’il est tard. Mon retard est vite rattrapé mais nous continuons nos apartés après les cours.

Un fois par semaine monsieur Hillaire nous emmène en balade en forêt pour ramasser des glands destinés aux cochons des éleveurs des environs. Nous chantons à tue-tête une chanson à la mode:
J'ai perdu le "do" de ma clarinette J'ai perdu le "do" de ma clarinette
Ah, si papa savait ça, tra-la-la Ah, si papa savait ça, tra-la-la Au pas camarad', au pas camarad' Au pas, au pas, au pas! Au pas camarad', au pas camarad' Au pas, au pas, au pas!
Ces sorties m’affament : le grand air et les privations car j’ai beau être guéri de mon impétigo et de la jaunisse, j’ai besoin de fortifiants et d’aliments riches mais tout est rationné. J’ai faim en permanence.
Quand je pense à l’épicerie de ma mère à Thionville où il y a tout ce qu’on veut et à profusion. La nuit je fais des cauchemars qui effraient ma mère parce que je hurle : ce ne sont que ripailles où je me bats avec d’autres affamés. En cachette j’ai gouté le tourteau qu’on donne aux vaches. C’est mangeable, c’est presque une friandise lorsque j’ai trop faim. C’est mon ultime recours quand j’ai la fringale. Ce sont des résidus de pressage de graines de fruit oléagineux et ça ressemble à des petits pains ronds moulés.
Pour les balades j’emmène un casse-croute de restriction et une fiole pharmaceutique Loraga que je remplis de lait : elle est plate et son bouchon se visse. C’est idéal comme gourde. En plus, comme c’est loin de me suffire, je prends aussi du tourteau. Notre instituteur nous apprend à faire des paniers d’osiers en prélevant ce qu’il nous faut de branches sans fâcher les propriétaires des saulaies. Ces paniers, tout le monde en fait par ici, ils ne valent pas grand chose et si je veux en tirer quelque argent pour manger, il va falloir que j’exporte mes paniers !
LA SAILLIE
En classe, pour ma première rédaction, je dois relater un évènement important qui concerne le village : je suis bien embêté car je ne sais pas grand-chose de la vie à la Motte du Caire mais en me creusant la tête, je me souviens de ce qui m’a frappé le plus depuis que je suis ici et je me mets au travail.
C’est un jeudi, pas d’école et avec mes copains nous voyons arriver une bétaillère inconnue au village. En sort un étalon fougueux qui marche en équilibre sur ses pattes arrière. C’est très impressionnant, sa longe que tient le palefrenier, est tendue à la verticale, il souffle puissamment et il pousse des hennissements bruyants.
Mes copains savent tous ce qui va se passer, pas moi. Tout le monde suit le cheval et j'emboite le pas.
Dans mon devoir je raconte comment on met le cheval en présence d’une jument qui refuse absolument de se laisser approcher par derrière : elle lui envoie de méchantes ruades. On lui présente ensuite une autre jument et celle-ci reste paisible et tranquille, pas effarouchée du tout par cet étalon nerveux. Elle doit connaître la chanson. Après son coup manqué, le cheval, lui, est au comble de l’excitation : je peux le voir à ce qui dépasse de façon évidente sous son poitrail.
Je n’ai jamais vu ça, le cheval essaie de grimper sur le dos de cette pauvre jument avec son attribut pointé en avant. Mais il est si impatient que son palefrenier est obligé de le guider à la main vers la femelle, une poussée de tout l’animal et le membre viril du cheval fait son entrée dans la jument.

Les yeux écarquillés, je retiens mon souffle, j’entends à peine les copains qui commentent, « ça y est ! Le cheval doit être bien content à présent !». Certains d’entre eux fouillent dans la poche droite de leur pantalon. Moi je ne peux pas avec mon pantalon qui n'a qu'une petite poche sur le devant à l’aine. Mes vêtements,c'est ma mère qui les fait. Elle a d'autant de mérite qu'elle n'est pas couturière : elle ne sait pas faire les braguettes et mes pantalons sont tous à ponts comme ceux des marins, avec des boutons sur le côté, à cause du tangage peut-être.
Quand mon instituteur nous rend notre travail, il commente ma rédaction chevaline comme un bon travail d’observation mais hors sujet. Cette histoire de saillie, même si elle m’a marqué, n’a rien d’extraordinaire par ici. A la campagne, c’est une chose courante dans les fermes. C’est pour ça qu’il m’annonce que ma rédaction ne sera ni notée ni commentée en classe et qu’il me faudra la refaire.
Pour moi ce n’est pas juste ! Je suis déçu et vexé car je n’ai pas l’habitude de l’échec. Je boude et je me braque : je ne referai pas ma rédaction ! Pour éviter de me soumettre, je fais le malin en déclarant que je ne connais rien d’autre d’important ici. Ce n’est pas vrai mais je suis buté.
Heureusement mon instituteur aime bien mon esprit frondeur et il n’est pas dupe : il consent à admettre que mon devoir n’est pas si éloigné du sujet que ça et il étalera une compensation sur les prochaines notes pour ne pas léser ma moyenne. Ça me va : je n’ai pas plié et mon honneur est sauf.
LA DÉBROUILLE
Pour exporter mes paniers, j’ai besoin d’un vélo. J’emprunte des bicyclettes hors d’usage que je passe beaucoup de temps à remettre en état. Ni freins ni garde-boue, c’est plus facile pour freiner : il suffit d’appuyer avec le pied sur le pneu avant. Les pneus bien sûr sont usés jusqu’à la corde, les chambres à air poreuses.
En partant, il ne faut pas oublier la pompe car il faut regonfler plusieurs fois en route et la pompe est asthmatique, le raccord fuit. Il faut penser à prendre aussi une paire de gants pour se protéger les mains de l’huile noire dont est enduite la chaine qui saute à tout bout de champ et qu’il faut remettre en place à la main.
Mais me voilà parti pour prospecter les fermes isolées hors de la ville. Avec moi deux paniers de ma fabrication à échanger contre de la nourriture. Je vais de plus en plus loin et je vais pouvoir honorer ma promesse à Gabriel car j’approche de Nibles. Plus qu’une terrible côte à monter pour rejoindre Chateaufort et revoir Gabriel.
Avant d’attaquer la descente vers le village, je me souviens juste à temps que je n’ai pas de freins, et je m’arrête pour reprendre mon souffle. Pas loin se trouve une ferme et je rencontre madame Aubin qui me demande d’où je sors et à qui je raconte mon histoire.
« Ôh peuchère ! » s’exclame-t-elle avant de remplir un de mes paniers avec de bonnes choses. Je reviendrai encore et nous ferons plus ample connaissance. Les Aubin ont contracté un mariage consanguin : ils sont cousins et se sont mariés pour réunir trois fermes et les cultiver. Ils ont eu trois fils handicapés. Maurice, vingt six ans, admis de justesse pour le service militaire comme auxiliaire, René, dix neuf ans et un peu simplet : pas de service pour lui et André, dix ans, même prénom que moi, même âge que moi, même jour même mois.
André a l’air normal mais il est débile profond, il ne contrôle pas ses excréments et fait des tours pendables. Il fait dévaler toutes les courges du champ du dessus sur la ferme et la plupart du temps il est enfermé dans l’étable avec les bêtes car il est trop difficile à surveiller. Quand j’arrive et que la ferme est déserte, j’entends sa complainte : « zin… zin ……zin……» et je lui parle. Quand il est calme, je le libère.
Le père Aubin me dit, embarrassé, ses espérances ruinées à jamais. Il déplore de ne pas avoir de fils fort comme moi.

Moi, ce que je déplore c’est de ne pas avoir de bicyclette en bon état pour venir jusque chez eux. Mais « une bicyclette fonctionnelle », autant ne pas y penser : une bicyclette coûte très cher et en plus, elles sont réservées aux facteurs comme monsieur Massot par exemple.
Ma mère s'est liée avec madame Magnan : elle a la cinquantaine et trois enfants. Adolphe, l’ainé, est prisonnier de guerre comme mon père. Berthe est préposée aux poste au village et Marthe, la petite ménagère de la ferme a seize ans. Les moutons de madame Magnan sont partis en transhumance. Le berger a pris avec lui la chienne Toulouse. Moi, je garde l'unique vache de madame Magnan pour les vacances. Je dois la conduire sur un des rares plateaux herbeux des environs. C’est si loin du village que je ne peux même pas entendre le son de la cloche de l'église. Je plante un bâton dans le sol : c’est le soleil qui me dira l’heure de partir.
Une montre ça serait mieux mais je n’ai pas encore fait ma communion : je demande à ma mère de me prêter la sienne mais elle hésite avant d’accepter, une chute lui serait fatale et il faut que je fasse très attention car une montre n’est pas un jouet !
J’aurai bien aimé avoir Toulouse avec moi, une chienne est de meilleure compagnie qu’une vache : pendant qu’elle broute l’herbe rase, je m’ennuie. Je m’exerce à tailler des branches avec mon Opinel, un couteau que j’ai eu en cadeau avec un manche en hêtre et je chante "j’aime tes grands yeux… " en rajoutant, "tes grands yeux de vache " comme tout le monde le chante partout pour rigoler.
Finalement, alors que j’ai le dos tourné ma vache s’approche de moi et fait mine de me grimper dessus ! je ne l’ai pas senti venir et j’ai peur qu’elle soit "amoureuse" comme on dit. Ça m'apprendra à chanter n'importe quoi.
Quand je raconte ça à madame Magnan, celle-ci prend une deuxième vache en garde et maintenant l’ancienne me fiche la paix. ouf.
Monsieur l’instituteur me dit à la rentrée que je ne suis pas fait pour garder les vaches : je me demande s’il a entendu dire quelque chose sur moi à ce sujet…
UNE PURE JOIE
Un soir sur le bus accroché à côté de la bétaillère, un superbe vélo junior me tape dans l’œil. Le chauffeur descend et crie mon nom dans le couloir en bas des escaliers. La bicyclette est pour moi !
Je me précipite pour toucher le rêve : du premier coup d’œil j’ai déjà vu qu’elle est munie des derniers perfectionnements. Elle a même une petite sacoche en cuir avec des outils. Je l’enfourche et les voisins baissent la selle au maximum : mes pieds touchent à peine le sol. C’est la joie, une émotion qui marque pour la vie entière.
La nuit tombe trop vite pour moi et malgré le superbe éclairage à dynamo, je suis bien obligé de rentrer. A la maison, je peine dans les escaliers pour la monter au deuxième étage mais je la veux près de mon lit pour la voir encore.
Epuisé je sombre, ma main posée sur le guidon.


L’argent pour la bicyclette vient des doublures de nos vêtements où ma mère l’avait cousu avant notre expulsion, en prévision du retour de mon père de captivité.
Ma mère pense à lui sans ses cigarettes ! Car si une chose manque, c’est bien le tabac. Elle ne loupe aucune occasion de s'en procurer et amasse donc dans une grande coupe tous les paquets qu’elle peut trouver pour le jour où il sera libéré. Pour moi et mes copains, fumer est une des choses à faire pour avoir l’air adulte et ils fument ce qu'il trouvent mais surtout une plante dont la tige a l’avantage de ressembler à une cigarette et dont les fibres laissent passer l’air, la liaune, une sorte d’herbe folle à fleur blanche, une clématite.
Mais j’ai sacrément envie de goûter les cigarettes que ma mère garde précieusement : comment faire sans qu’elle s’en aperçoive ? Mon père au contraire des autres, ouvrait toujours ses paquets proprement, sans les déchirer, alors, je gonfle légèrement la base du paquet pour pouvoir ouvrir le haut sans déchirer le papier et je subtilise une cigarette. Fumer me fait tousser et me dégoûte à jamais du tabac.
FRAYEUR NOCTURNE
La nuit, l’éclairage public est camouflé, un soir ma mère m’envoie en course.
Dans le noir, j’entends un bruit de moteur qui se rapproche. Hors, depuis qu’il a contingentement du carburant, il n’y a pratiquement plus de circulation motorisée sur les routes. En regardant vers le ciel, je vois une lumière qui progresse rapidement, réverbérée par les fils du téléphone : je crois à une attaque aérienne.

Je me jette à plat ventre dans le fossé j’entoure ma tête de mes deux bras. Et finalement, qu'est-ce que j’entends? une voiture automobile en train de me dépasser. Elle s’éloigne déjà mais j’ai du mal à maitriser ma frayeur.
Un autre soir ma mère m’envoie chercher du sel à l’épicerie, il fait encore plus noir. Ma mère me dit : tu n’auras pas peur au moins. Je réponds fièrement que non mais je suis mort de trouille.
Pour limiter autant que possible le temps de mes craintes, je cours tête baissée au milieu de la chaussée et vlan! Je percute quelqu’un que je n’ai même pas vu. Nous tombons au sol tous les deux mais je me relève le premier et je prends la fuite immédiatement. Derrière moi j’entends crier dans la nuit « capoun des dios ! ven aqui galopio, qué yo t’aganta » ou en clair : je suis très fâché, si je t’attrape ça va barder !
Je rentre précipitamment à la maison : ma mère me demande où est le sel. Du sel ? J’avais même oublié que j’étais parti en chercher et je dis qu’il n’y en a plus. Le sel ? Il est répandu au sol là où j’ai fait ma rencontre. Ma rencontre, c’est Girard, le commis de la ferme Lagarde, un vieux garçon qui n’aime pas les enfants. Pour eux, il est une véritable terreur. Girard a la garde de la ferme et de ses dépendances dont le verger, qui jouxte notre terrain de football. Les ballons qui passent la clôture nous sont tous renvoyés crevés par Girard sans autre forme de procès. Quand il n’est pas là nous devons user de ruses de sioux pour récupérer le ballon à nos risques et périls avec la promesse d’un coup de pied au cul.
Mais jamais un de nous n’a osé défier Girard et moi qui l’ai envoyé au sol sans le faire exprès. C’est grave, j’ai peur en permanence de le rencontrer et je scrute les environs pour vérifier s’il n’est pas à proximité.

Nous sommes invités à une veillée campagnarde et par prudence je demande qui vient : Girard en est et je dis que je ne viendrai pas. Je dois m’expliquer et finalement on me dit que Girard n’est pas si méchant et qu’au besoin on me protègera. La rencontre a lieu et la paix est signée : je suis bien content de notre bonne entente mais elle sera de courte durée hélas !
A l’automne, le jour de la distillation, les paysans entassent leurs fruits gâtés en bout de la place du village. C’est là que va venir s’installer l’alambic. Il y a des pommes pourries en quantité.
Nous en faisons des batailles au lancé. Je ne suis pas le dernier à ce petit jeu mais là, je vise quelqu’un qui se baisse au dernier moment : la pomme bien pourrie arrive en pleine face de qui ? Girard justement !
Je m’enfuis et le fils Lagarde qui est bien plus grand que moi me donne la chasse illico. Il me rattrape au pied des escaliers. Je me cramponne à la rampe. Je pousse les cris stridents du goret qu’on égorge à la boucherie du village. Le fils Lagarde préfère me lâcher sans tarder : il sait que ma mère est vive quand des grands m’importunent.
LE MINOT ALEXANDRE

En fin d’année, les paysans ramènent leur coupe de bois sur la place du village : cela fait un tas impressionnant. Il fait très froid ici en hiver et il n’existe aucun autre moyen de se chauffer. Les paysans ont acheté en commun une scie circulaire à moteur. Pendant des jours et des jours on entend le bruit combiné du sciage du bois et du moteur à explosion, c’est un bruit amusant et vivant. Le bruit du moteur varie en fonction de l’effort demandé : quand il peine de trop, il se défend lui-même, tout seul avec son starter automatique. Je me demande toujours s’il va gagner ou finir KO.
Des tâcherons sont là pour fendre les bûches à la hache ou bien à la masse avec un coin de fer enfoncé dans la bûche. Parmi eux une femme, madame Dieudonné, la mère de la petite Victorine qui est si maigre. C’est une expulsée, une ancienne foraine, elle a la carrure et le parlé d’un homme. Et elle fume. Après le travail cette équipe de fiers à bras va boire un coup au café du coin, puis encore un coup, c’est connu on va au café pour boire des coups.
Madame Dieudonné est déjà bien éméchée quand on lui demande ce qu’elle faisait sur les champs de foire. Elle dit qu’elle était cracheuse de feu, ce qui n’est pas vrai car c’est son mari le cracheur de feu. Tout le monde veut voir ça, une collecte est rapidement organisée pour le spectacle et on se procure de l’essence pour. Madame Dieudonné en verse par erreur sur son corsage qui s’enflamme spontanément : les hommes se précipitent pour éteindre le feu mais madame Dieudonné est gravement brûlée. Le docteur droit est appelé et donne les premiers soins en pestant contre tant d’imbécillité : il ne l’envoie pas dire !

Le maire du village est menuisier. Je le découvre en passant devant la porte ouverte de son atelier. Il me dit d’entrer et d’instinct, en retrouvant les odeurs et l’ambiance de la menuiserie de Willy à Thionville, je prends le balai et je rassemble les copeaux pour les ramasser. Le maire me dit que si je veux je peux être l’annonceur à la criée de la Motte du Caire, il me donnera cinquante centimes chaque fois.
Cela me convient, je vais enfin gagner des sous. Le maire me remet une petite trompette d’usage. Elle ressemble en tous points à celle des employés du chemin de fer. Je la fait briller comme jamais et je m’entraine en douce à déclamer les annonces. Je démarre bien vite dans ma nouvelle fonction. Je repère les points de rassemblement et je souffle très fort dans ma trompette. « Avis ! le grand canal sera ouvert de deux à six heures ! qu’on se le dise ! » Voilà le genre de déclaration que je fais.
Maintenant tout le monde me connaît, je suis le « minot Alexandre ». Mon prénom est pourtant André mais les gens préfèrent m’appeler Alexandre, des André, il y en a déjà plein d’autres au village. Ils rient de mon accent lorrain, ils disent que je mange la fin des mots. C’est à voir : à Thionville on m’a bien appris que le E qui termine un mot est un E muet. Qu’importe ! je ne vais pas m’offusquer pour si peu, je ris avec eux : si je mange la fin des mots c’est que j’ai toujours grand faim !
Du coup on m’apporte des petits encas, des fruits, des spécialités du pays. J’apprécie beaucoup tout ça.
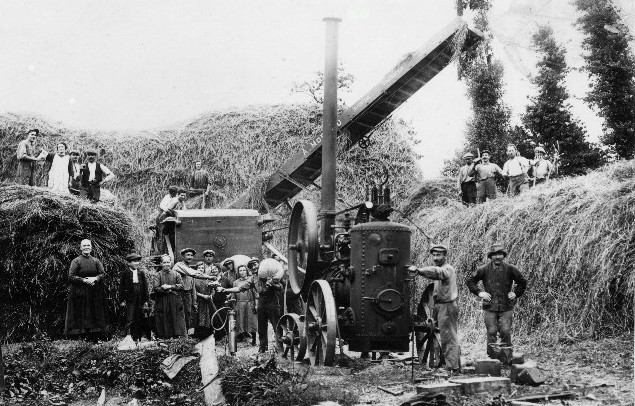
L'été, c'est le tour de la machine à vapeur de débarquer au village pour le battage. D'un côté la locomobile, de l'autre la batteuse, reliées par une immense courroie et deux grands tas: le blé en gerbes d'un côté, la paille de l'autre. Il y a toujours un coup de main à donner et
nous nous en donnons à cœur joie à jouer dans la paille.
Pour la fête des moissons on me demande de chanter. Ça je m’y attendais! Ils veulent encore rire de mon accent. Mais j’ai préparé mon coup, ils vont être bien surpris : je monte sur l’estrade improvisée avec une grande charrette à foin et j’entame le Coupo santo, une chanson d’ici. « Coupo santo et versanto, woédge à plein bord, woédge abord li estrambords, c’est l’énavant du fort. »
Après ce couplet en patois, ils en demandent une autre et là je chante avec ferveur « ce soir à minuit c’est la fête au villageu et nous danserons sous les platanes verts, j’aurais dans mes bras la fille la plus sageu et vogue, vogue mon ivresse et vogue, vogue mon cœur lourd » des platanes il y en a justement et des filles aussi : je suis applaudi.
GINOU ÉCLAIRE L'ÉTÉ

Les estivants de Marseille arrivent. Ils m’apportent des vêtements devenus trop petits pour leurs enfants, des livres et même un petit appareil de projection en carton qui montre des dessins animés. Mais le plus beau cadeau c’est Ginette Sarlins. Elle vient à la Motte du Caire avec sa tante, une institutrice célibataire et elles vont rester ici toute la durée des vacances scolaires.
Ma Ginou est si belle, si agréable, si gracieuse que j’en oublie tout le reste. Nous sommes inséparables. Nous partons à bicyclette faire le tour des fermes que je visite. Bref, j’ai douze ans et je suis amoureux fou : ça se voit et les gens amusés appelle ma Ginou, madame Alexandre. Nous sommes très flattés d’être pris au sérieux, c’est très important pour nous. Quand je chante en public, je chante sa chanson préférée, "ce soir à minuit, c'est la fête au village et nous danserons sous les platanes verts", une chanson de Léo Marjane. En chantant, je ne la quitte pas des yeux.
Dans la cour de l'école, mes petits copains se regroupent toujours pour jouer à qui battra le record de hauteur en atteignant le crépis au dessus du bitume de la pissotière. Ils s'entrainent aussi à faire des ronds sur le sol. Pas moi : c'est à cause de mes pantalons à pont parce que quand j'ai besoin de faire pipi, je cherche un coin tranquille car j'ai besoin de déboutonner tout l'avant de mon pantalon.
Un jour je sens qu'il se trame quelque chose dans mon dos mais avant de comprendre, mes copains me tombent tous dessus en même temps m'arrachent mon pantalon et un fois leur forfait accompli, se dispersent en riant et en chantant " maintenant tu n'as plus b'soin de la cacher ta zigounette, on l'a tous vu!" Ce jour là, Ginoux n'est pas loin! Je me relève furieux pour me lancer à leur poursuite. Je cours avec une main pour tenir mon pantalon et l'autre brandissant en l'air la boucle de mon ceinturon.
Mes copains finissent par s'excuser: ils voulaient voir si je n'étais pas juif! "tiens! mon œil: la communion on l'avait fait ensemble!"
UNE AMIE QUI TOMBE A PIC
Ma mère a fait la connaissance d’une personne qui vient de Marseille tous les quinze jours. Je savais déjà avec ma curiosité naturelle, qu’elle travaille pour le P.L.M, le train qui dessert Paris Lyon Marseille, qu’elle voyage gratuitement et qu’elle s’appelle madame Grégoire. Quand elle vient elle séjourne un jour où deux à l’hôtel. Elle vit seule avec son fils qui est plus grand que moi et elle vient ici pour chercher des provisions pour lui : il doit avoir la même maladie que moi car lui aussi a toujours faim.
Ma mère se lie tout de suite avec madame Grégoire, elles sont seules toutes les deux avec un garçon à charge qui a toujours faim. Ma mère invite madame Grégoire à faire l’économie de l’hôtel et de séjourner chez nous à chaque voyage.
Ma mère décide qu’elle ira elle-même chiner dans les fermes pour ramener le ravitaillement. Madame Grégoire annonce sa venue, ma mère se hâte de visiter les fermes à bicyclette. Elle est en nage dans les montées. Elle descend en vitesse les pentes dans la fraicheur boisée. Elle attrape froid.
Dans la nuit ma mère est au plus mal. Elle délire. Elle me dit d’empêcher le réveil de tomber. Je lui crie en pleur d’arrêter, nous n’avons pas de réveil ici, le nôtre est à Thionville.... C’est le milieu de la nuit, je la laisse seule et je bondis chercher le docteur Droit. Je crois que je vais casser sa porte mais il se lève et revient avec moi : il diagnostique une pneumonie.
Il fait une piqure à ma mère qui l’assomme et il me dit de rester éveillé pour la surveiller. Je sais déjà combien c’est grave : je viens de conduire au cimetière le solide bûcheron du village qui est parti en cinq jours de sa pneumonie à lui. Il a laissé sa femme et quatre petits enfants. Nous sommes en 1942 et ce mal implacable ne se soigne qu’avec des cachets, des cataplasmes de farine de lin et de moutarde sur la poitrine et des ventouses dans le dos. La pneumonie alors est un véritable arrêt de mort.

Ma mère émerge de son sommeil de temps en temps. Je lui parle. Elle est indifférente. Je vois dans ses yeux pitoyables qu’elle ne me reconnaît pas.
L’après midi même arrive madame Grégoire comme prévu. Elle a été infirmière militaire, elle a de solides notions de soin et elle prend les initiatives nécessaires. Je n’ai pas beaucoup dormi. Madame Grégoire m’envoie à l’école, elle s’occupera de tout.
Mon instituteur sait tant de choses. Alors je lui demande ce que je vais devenir si ma mère décède. Il sait qu’il ne faut pas finasser avec moi et il prend son temps pour me répondre. Dans mon cas ce sont les autorités militaires qui s’occuperont de moi. Je serai vraisemblablement déclaré pupille de la nation[15] en qualité d’enfant de troupe. Je lui demande si on va m’envoyer à la guerre, il me dit que non.
Deux solutions sont possibles : soit je suis placé dans une famille de confiance à qui une allocation sera versée pour ma prise en charge, « chez les Magnan ! Ce serait bien ! ». Soit, en fonction de mes résultats scolaires, j’intègre une pension à rigueur militaire pour faire des études supérieures et une carrière militaire.
C’est une cruelle incertitude de devoir attendre toute une semaine pour savoir si ma mère mourra ou vivra. Depuis notre balcon je regarde la montagne : elle est solide, elle. Mais ma mère passe le cap fatidique des neufs jours. Et elle se remet en une nuit comme c’est connu pour cette maladie là.
LA VIE A MARSEILLE

Madame Grégoire doit rentrer au plus vite : elle a eu un congé exceptionnel d’assistance familiale du P.L.M et elle ne doit pas en abuser. Alors elle décide de nous emmener avec elle à Marseille.
Pour ça nous préparons des vivres en quantité : nous avons même des lapins vivants que je mettrai dans l’abri à combustible dans la cour que je nourrirai avec des fanes de légumes récoltés sur les marchés.
A Marseille, chaque jour je sors glaner chez les maraichers et aux ventes d’exception : un boulanger vend sans ticket et à la sauvette, des chutes de pain grillé. Il est en règle avec le contrôle économique, ce n’est pas du pain. Je dois prendre ma place dans une queue interminable.
Au retour je passe devant une vieille mendiante pitoyable assise sur une marche dans l’encoignure d’un porche. Faute de sous je dépose un morceau de pain grillé dans le gobelet qu’elle a disposé devant elle sur un mouchoir étalé.
Pierre, le fils de madame Grégoire s’inquiète des mes sorties en ville. Il me faut faire attention car il y a ici des hommes qui kidnappent les enfants. Ils les emmènent sur leurs bateaux : c’est pour les vendre comme esclaves. Il me dit de ne jamais accepter d’argent d’inconnus et que si un homme est trop souvent à côté de moi, s’il insiste pour me parler, je devrai le dire à un policier. Lui comprendra mieux que moi le pourquoi.

Marseille est un enchantement : il y a des tramways et des trolleybus, des cinémas permanents où on peut voir des dessins animés, la promenade de la Joliette, le vieux port avec le pont transbordeur, le funiculaire qui monte à Notre Dame de la Garde, les promenades en mer, les grands magasins à entrée libre avec ascenseurs pour desservir les étages.
Pierre m’inscrit au cercle des nageurs de la plage des Catelans : je sais nager maintenant. Tous les jours je vais avec mon ticket de rationnement E chercher mon quart de lait à l’épicerie d’à côté. L’épicière me demande si je veux gagner des sous.
Il suffira de venir sur les coups de dix heures, donner un coup de mains aux clientes surchargées. Ces dames doivent être riches, il n’y a qu’à voir tout ce qu’elles achètent : en portant leurs commissions j’obtiens de généreux pourboires.

LA LIBERTÉ


Maintenant que j’ai des sous, Pierre veut savoir combien « dis donc garçon de courses ! Tu ne gagnerais pas plus que moi des fois ? » C’est mon secret. Je vais à la foire sur les autos électriques : pas les autos tamponneuses mais celles qui roulent sur un circuit en anneau. C’est plus cher mais j’ai juste assez. C’est interdit au moins de douze ans, je les aurai la semaine prochaine, c’est bon comme ça.
En piste je négocie très bien mon premier virage. Je suis content de moi. Mais je ne sais pas qu’il faut redresser ensuite et la voiture qui me suit vient me pousser par le côté en me faisant riper en travers de la piste. Le courant est coupé, on arrête la circulation. On aligne les voitures en vitesse et un employé de piste prend place à côté de moi dans la voiture : c’est lui qui tient le volant pour le temps qu’il me reste.
Appuyé contre la balustrade, je regarde les autres tourner. Comment ai-je pu être aussi bête ? Un homme que je n’avais pas remarqué m’interroge à mon air dépité : « tu n’as plus de sous hein ! » je lui dis que si et je m’esquive en lui disant que je vais sur l’autre manège, celui où on a le droit d’avoir des accidents…

Je vais au cinéma permanent pour me mettre à l’abri des mauvaises rencontres. Je choisis un film en technicolor « Hula, fille de la brousse ». Pendant les actualités, l'éclairage de la salle doit rester allumé parce que des gens lancent vers l'écran des projectiles de toutes sortes dont des boules puantes. Tout le monde n’est pas d’accord : « Quelle bande d'ingrats, quand les allemands se battent seuls dans l'adversité contre le bolchevisme ».
A l’écran, on nous montre la vaillance des soldats allemands sur le front russe. Ils ont de grosses difficultés pour circuler à cause de la neige. Le carburant gèle. Les soldats souffrent du froid intense. Les quolibets grivois vont bon train à propos des parties du corps des soldats qui doivent le plus souffrir du froid « on se les gèlent bien, hein mein Führer !!! »
Les gens se prélassent à regarder ça amusés et goguenard, assis dans leurs sièges confortables. Puis on nous montre la relève des prisonniers de guerre français. L'échange se fait à raison de trois volontaires pour un prisonnier. Les partants pour l'Allemagne sont attirés par une grosse prime d'engagement ainsi que par la promesse d’un salaire triplé. On nous montre bien le train de retour des prisonniers. Vive Pétain ! vive Laval ! Puis moins bien celui des partants: autour de moi, on dit ils y a parmi eux des raflés rebelles au STO [[16]] mais aussi des souteneurs et autres marginaux de tout poils. Ce qui explique la présence de la police française. Ils partent dans des vieux wagons réformés, attelés in extremis en queue de trains à bestiaux en partance pour l'Allemagne. Bon voyage.
Enfin le film : il y a plein d'animaux sauvages et surtout... des crocodiles! C’est si fascinant que je veux revoir certains passages.
Hula vit seule dans une grotte et toute petite, elle a été adoptée par un tigre. Devenue grande elle est si belle qu'elle plaît à tout le monde.
J’enchaine plusieurs séances de suite en changeant de place pendant la projection : j’essaie d’avoir l’air physiquement différent, je veux éviter de me faire éjecter comme cet après midi.
Quand je sors, il fait nuit noire, je n’ai pas vu le temps passer mais je réalise quand j’aperçois au loin ma mère et madame Grégoire. Si elles sont parties longtemps à ma recherche comme ça dans les rues, je sais que ça va barder . Ma mère veut me corriger mais elle a du mal à me secouer, je suis trop lourd maintenant.
Alors elle me serre très fort contre elle en pleurant qu’elle ne veut plus que je lui fasse vivre une inquiétude pareille. « Dans les grandes villes il y a des sadiques ! » je demande ce que c’est : « ce sont des hommes qui éprouvent du plaisir à torturer les enfants. Ils les tuent après. »
Il ne manquait plus que ça, quel dommage que Marseille soit une ville si dangereuse !

Je continue à porter mon béret dans la rue pour narguer les allemands même s'il est devenu trop petit.
Mais j'ai beau les braver en passant sous leur nez, rien n'y fait, ça n'a pas l'air de les toucher.
Je rage mais je ne peux pas aller plus loin dans la provocation sans me mettre en danger. Alors je demande à ma mère d'acheter un blason lorrain par l'intermédiaire du journal des expulsés.
C'est un blason orné d'une croix de Lorraine et d'un chardon, sa devise est " qui s'y frotte s'y pique!" Ma mère le coud sur la pochette de ma veste et me voilà paré pour défier ces allemands! Peine perdue: quand ils remarquent mon blason, ces messieurs s'approchent avec bienveillance et me disent: " ein junge lothringer, zehr gut sprechen sie deutch?......... Nein!! je crie en réponse.
Les vacances scolaires prennent fin la semaine prochaine, nous repartons à la Motte du Caire. Ma mère me dit qu’elle ne m’a pas beaucoup vu regarder mes livres d’école : « mais maman, je les sais déjà tous par cœur ! Tu le sais bien puisque c’est toi qui me fais réciter ! » Dans le train du retour j’ai le cœur gros de laisser tout ça mais je me réjouis déjà de tout ce que je vais pouvoir raconter à mes copains à l’école. C’est qu’ils ne quittent jamais le village eux !
YVONNE

A mon retour j’apprends qu’Yvonne Kaiser-Zimmerman que j’avais laissée à Sisteron lors de la répartition des réfugiés dans les villages, est restée sur place. Je me revois encore derrière la vitre du bus en partance pour Chateaufort. Je n’ai qu’une hâte, c’est de faire avec ma bicyclette les vingt kilomètres qui nous séparent.
Je prends avec moi six œufs, deux tommes du saindoux, des pommes de terre. Sur la route je suis contrôlé par les agents du contrôle économique : ils visitent les fermes et comptabilisent les poules et tout ce qui peut se manger. Je n’en savais rien et je me fais confisquer la moitié de mes vivres : je suis furieux et j’ai envie de devenir grand pour en découdre avec tous les imbéciles. Je les regarde droit dans les yeux en cherchant sur leur visage la trace de leur bassesse.
Je retrouve enfin Yvonne et sa famille. Sa mère est remariée avec un alsacien. Yvonne a maintenant une petite sœur Charlotte qui, malheureusement est trisomique[17]. Les Zimmerman sont mal vus à Sisteron car ils parlent alsacien entre eux dans les rues et les gens trouvent que ça sonne pire que l’allemand : on les appelle les boches de la rue Deleuze. En plus ils traitent la sœur d’Yvonne de tête de boche. Ces enfants là se ressemblent tous un peu dans le monde entier, c’est méchant odieux et mesquin.
Quand je rentre au village je convaincs ma mère de prendre Yvonne avec nous quelques mois.
En octobre, ma mère va à Lyon chez monsieur et madame Neige. C’est un couple de retraités qui a quitté Thionville en quarante et à qui mon père a confié quatre gros volumes Larousse quand il a compris que ma mère n’utiliserait pas la Simca 5 pour s’enfuir.



Les Larousse, il les a achetés pour moi. Pendant l’évacuation en 1914 il avait neuf ans et il était orphelin. C'était la guerre et il avait passé quatre ans réfugié à Milli-la-Martine à travailler comme un homme, au lieu d’étudier. Ainsi, il est sûr que j’aurai ce qu’il faut pour apprendre. Ma mère ramène l’encyclopédie qui va me servir tout le long de ma scolarité et m’aider parfois à surprendre mes professeurs par mes connaissances. Les Neiges ajoutent en cadeau, une véritable luge de Megève avec des patins en forme de ski. Les enfants du village ont l’habitude de glisser sur une piste qui se termine par une butte où les luges viennent s’arrêter en douceur.
Le jour où j’inaugure ma luge, j’invite mon copain Antoine. Nous allons si vite, qu’arrivés sur la butte, au lieu de stopper, nous décollons. Antoine est largué dans les airs mais moi je continue ma course vers la Sasse, la rivière qui coule en contrebas. Heureusement je finis dans une haie providentielle. Cette luge est une vraie curiosité !

Yvonne et moi sommes si bien à la maison. Nous faisons nos devoirs ensemble et d’autres filles participent à nos soirées studieuses. Après les devoirs nous jouons à des jeux de société ou bien je projette des dessins animés avec mon projecteur en carton pendant qu’Yvonne lit les commentaires à la lueur d’une bougie.
La rentrée suivante, Yvonne rentrera aider sa mère qui a besoin de faire garder Charlotte. Un nouveau déchirement. Je lui demande de ne pas pleurer et je lui promets de lui porter du ravitaillement chaque semaine.
LES ITALIENS
Nous sommes le 14 juin 1942, je fais ma première communion.

Le 11 novembre la zone libre est supprimée et notre région dépend maintenant du « Doutché » (Mussolini). Un détachement de soldats italiens prend ses quartiers dans la citadelle de Sisteron. Ils sont calmes et paisibles et loin d’être aussi hargneux que les allemands.
A la fin de 1943, ils viennent faire un exercice à la Motte du Caire. Ils creusent une tranchée, mettent quelques mitrailleuses en position et disposent leurs armes en évidence, fusils en épis et alignement de grenades. Je n’ai pas de mal à parler avec eux car l’instituteur nous a enseigné quelques notions d’espéranto[18]. C’est une langue internationale.
Ces soldats aiment les fruits. Quand ils sortent des magasins ils en ont le bras chargés et ils m’en donnent.
Certains d’entre eux me disent que cette guerre idiote a exterminé vingt mille italiens à Ben Gazi en 1941. Ils sont très bien chez nous et n’aspirent qu’à terminer cette guerre sans trop de casse. Les gens disent d’eux qu’ils préfèrent jouer de la mandoline que de la carabine.
Quelques jours plus tard deux d’entre eux reviennent incognito et en civil prendre une chambre à l’hôtel d’en face.
La frontière italienne n’est qu’à soixante six kilomètres du village. Et ils ont décidé de prendre la fuite et de gagner le maquis des montagnes. Mais au cours de la nuit j’entends des cris et des menaces dehors : des jeunes du village ont trouvé malin de cacher les bicyclettes des deux déserteurs et ceux-ci réclament la restitution de leur vélo ou qu’on leur en procure d’autres. Ils sont très fâchés et menace de fusiller des otages ! Ni une ni deux, je démonte les roues de mon vélo tourne le guidon de travers et arrive à dissimuler le tout dans les combles de la maison.
Peu après ce sont les allemands qui arrivent au village : avec ma trompette, je suis chargé d’annoncer solennellement que tous les habitants doivent se rassembler, enfants compris, sur la place du village. Il fait très chaud. Le grand chef prend la parole après un salut hitlérien bras tendu. Il nous ordonne avec autorité de remettre les armes que les italiens auraient laissées derrière eux et tout ce qu’ils auraient pu troquer en échange de vêtements civils.
Il ajoute que quiconque cacherait des italiens ou des biens militaires sera exécuté sur le champ. Un citoyen apporte une machine à écrire qu’il dit avoir trouvée dans son jardin. Les allemands repartent pour Sisteron dans un ordre impeccable. Les gens sont soulagés de leur inquiétude, on dit tant de choses sur leur barbarie, certains tentent d’ironiser : « après les doryphores et les charançons ils ne manquaient plus qu’eux ».
LE CERTIF
Le treize juillet 1944, je passe le certificat d’études. C’est très important pour moi car mon avenir en dépend. L’instituteur a dit à ma mère que je ne suis pas fait pour garder les vaches et que je dois continuer mes études. Il a parlé comme si j’étais son propre fils. Si j’ai le certif, je pourrais être admis d’office au prestigieux collège technique Vaucanson à Grenoble à cause de ma situation familiale.
Ma mère n’a pas dormi de la nuit, elle est folle d’inquiétude et m’en veux d’être si décontracté et de chantonner par un jour pareil. Mais je suis sûr de moi. Pourtant j’ai un point faible, la géographie.
La chance est avec moi car la question orale tombe sur la Russie. Je suis passionné par ce pays, j’ai déjà écouté radio Moscou et j’ai retenu la sincérité de l’appel aux prolétaires de tous les pays : « unissez-vous ! » Cela m’a profondément ému. Alors je n’ai aucun mal à parler des greniers à blé d’Ukraine et des tonnages faramineux de l’industrie lourde. Mes examinateurs sont soufflés par mes connaissances et mes commentaires bien au-delà du programme et j’obtiens mon certif haut la main. Je me classe premier du canton, il n’y a plus de mentions et mon instituteur est déçu. Il tempête contre les enseignants.

Ma mère prépare mon trousseau de pensionnaire pour la rentrée. J’ai beaucoup grandi mais dans les magasins il n’y a plus rien à vendre, les tickets textiles ne servent à rien et les chaussures sont à semelles de bois. Ma mère cherche des vêtements de récupération et sollicite les gens pour qu’ils lui ouvrent leur grenier.
Nous faisons des découvertes historiques, des chemises de nuit en lin écru qui ont plus de cent vingt ans et un uniforme de hussard de la garde napoléonienne au complet, coiffe à plumet rouge compris. Le temps presse, ma mère a peur de ne pas finir à temps.
A la brocante de Sisteron nous trouvons une machine à coudre Singer portable qu’on pose sur une table et qui fonctionne avec une manivelle. Elle est finement décorée de motifs d’or, elle est impeccable. Dans les chemises en lin, ma mère me découpe des shorts aussi empesés que du blue-jeans et dans l’uniforme un blouson à fermeture éclair du plus bel effet.
LE MAQUIS
L’école est finie, la guerre l’est presque aussi. Pas assez vite à mon gré. Tout le monde résiste à présent : à Bayon, à douze kilomètres d’ici, un maquis s’est constitué.
J’ai quatorze ans et je veux moi aussi faire partie de la résistance. Je réussis à trouver le repère des maquisards et j’y vais souvent. Mais ils me disent que c’est trop dangereux pour moi. Moi, je ne veux rien savoir. Alors ils me proposent de participer en acceptant de faire le sacrifice de ma bicyclette pour la France. Ils ont besoin de ma bicyclette et ils me la rendront dès que possible mais je dois partir. C’est dur pour moi car ma bicyclette est un prolongement de moi-même. Mais je dis oui par patriotisme.
Quelqu’un me ramène à la Motte du Caire en vélomoteur dans la nuit. Le lendemain, j’apprends que le maquis de Bayon a été anéanti [19]: vingt et un morts au combat et trois fusillés dans une ferme voisine.[20]

Je prends le vélo de ma mère et je descends à Sisteron pour annoncer ma réussite au certif à Yvonne. Je la trouve prostrée et en pleurs : sa mère a été arrêtée et trainée dans les rues de la ville. Les gens lui reprochent d’avoir parlé souvent avec des soldats allemands, d'être une "collabo", alors qu'elle ne faisait que laver le linge de soldats allemands pour gagner sa vie.
Je demande, « Et alors ? : Elle doit être jugée pour ça ! » me dit Yvonne.

Madame Zimmerman est enfermée à la prison de la citadelle de Sisteron.
Je ressens ça comme une insulte à notre condition d’expulsés.
Outré je monte à la citadelle, je rencontre le commandant des F.F.I, les forces françaises de l’intérieur et il me dit qu’il a enfermé la mère d'Yvonne pour la protéger de la vindicte populaire.
" Trop de gens ont la gâchette facile en ce moment. Tout le monde veut venger les victimes du maquis de Tramalao à Bayon. Madame Zimmerman sera libérée quand il n’y aura plus de risques."
Il me dit aussi que sa fille est autorisée à lui rendre visite et lui apporter ce dont elle pourra avoir besoin.

Le docteur Droit est en fait un membre important de la résistance et il a quitté le village depuis quelques temps après avoir échappé au massacre du Tramalao.
A sa place vient s’installer un docteur Ciambaroni : on dit que c’est un faux médecin et que sa mission est d’espionner le maquis et ses attaches dans le village.
Un soir, le maquis fait irruption chez lui, il est enlevé.
Le bruit qu’il a été exécuté circule rapidement.
Sa femme comprend rapidement le lendemain quand elle reconnaît la chemise de son mari sur le dos d’un gars du village.
Les vêtements sont rares et chers… Ma mère dit à madame Ciambaroni d’espérer encore.
Mais je sais qu’on lui a demandé de creuser sa tombe et qu’il a essayé de gagner du temps en protestant de son innocence.
Nous n’avons plus de docteur.
L’HÔPITAL DE DIGNES
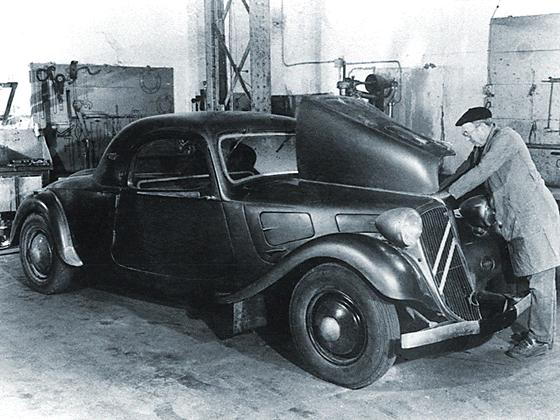
Nous n’avons plus de docteur et ça tombe mal : la nuit ma mère me réveille.
Elle a le bas du visage tout enflé et elle souffre beaucoup. Elle a peut-être les oreillons et pour éviter la contagion, je suis recueilli par les Magnan. Le lendemain le visage de ma mère est deux fois plus enflé : ce n’est pas les oreillons dont elle souffre. Sans docteur, le maire décide d’expédier ma mère à Sisteron.
Il fait appel à monsieur Touche, le garagiste du village. Il a des attributions spéciales de carburant pour acheminer les malades avec sa traction. L’hôpital de Sisteron est bien embarrassé par le cas de ma mère et en tout cas il ne pratique pas de chirurgie faciale. Ma mère est dirigée sur l’hôpital de Dignes.
Je lui écris tous les jours. Elle me répond mais je suis quand même très inquiet, cette période d’observation est bien longue. Et puis le courrier ne passe plus. Je m’affole : je ne reçois plus rien.
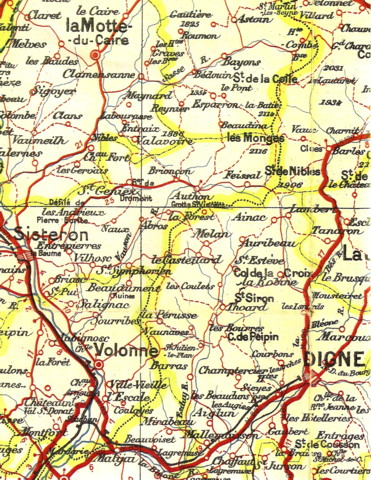
Et si on me cachait la mort de ma mère ? Ca existe ça ! On nous passe assez souvent les Roses blanches de Berthe Silva à la radio ! Il faut que j’en aie le cœur net.
Digne à vol d'oiseau, n'est pas si loin, voler, j'en rêve. Seulement, il me faudrait prendre des sentiers de montagne, passer des torrents à gué et même faire de l'escalade . Mon vélo est resté au maquis, et je me vois mal porter celui de ma mère à l'épaule dans les passages difficiles. Et pour tout dire, j'ai la frousse de traverser tout seul ces déserts montagneux, qui sait ce qu'on y parle comme langue, quels animaux dangereux je pourrais croiser: je prendrai la route par Clamensane, Esparron la batie, les Monges, Vaux et Barles.
Je dis à madame Magnan que dimanche j’irai à Chateaufort manger du lapin chez Gabriel. Elle me dit que j’ai bien raison, que ça me changera les idées. Le dimanche, je suis prêt de grand matin, « mais tu n’as plus de vélo coquin de sort ! Gabriel ne sera même pas encore réveillé quand tu arriveras ! »
J’ai bien préparé mon coup ! Cent vingt kilomètres aller-retour dans la journée, je n’ai jamais fait ça, j’emmène de quoi me restaurer. A Digne, ma mère me gronde et me présente fièrement à tout le monde : elle est bien contente quand même. On a trouvé de quoi elle souffre : c’est une maladie rarissime, de petits calculs obstruent les canaux des glandes salivaires.
Ma mère a appris à se masser le visage pour libérer ces blocages.
Rassuré je repars le cœur léger. Je roule en chantant et dans les descentes je me livre à des fantaisies qui auraient bien pu me faire tomber. Le village en vue, je ressens soudain une immense fatigue. Chez Magnan on veut savoir si le lapin était bon, quel lapin ? Je suis exténué et je veux dormir au plus vite.
Après une nuit de cauchemars, il y avait longtemps que cela ne m’était pas arrivé, je ne suis pas bien, j’ai mal au ventre et j’ai envie de vomir : je n’y arrive pas. J’avoue mon escapade à Digne à madame Magnan qui se précipite chez le maire qui dort encore. C’est mon tour d’être acheminé en urgence à Sisteron dans la traction de monsieur Touche.

BOMBARDEMENT DE SISTERON

A l’hôpital une piqure soulage mes douleurs, j’ai de la température, le docteur qui m’ausculte m’arrache des cris de douleurs quand il palpe mon ventre. Il me met à la diète car je serai opéré le lendemain.
C’est la nuit du 15 août 1944. Les alliés bombardent la ville pour détruire le viaduc. Le lendemain la ville est sinistrée mais les bombardiers reviennent finir le travail.
Il fait une chaleur torride, et les morts ensevelis sous les maisons deviennent un problème. Le pont sur la Durance est détruit et l’accès à la ville impossible. A l’hôpital les blessés affluent, il y a plus de monde qu’on ne peut en soigner, la salle d’opération est occupée en permanence. Et le docteur Robert, un des chirurgiens de l'hôpital, est mort en allant au secours des blessés: les avions alliés n'ont pas tenu compte de la croix rouge peinte sur le toit de sa voiture et l'ont mitraillé, causant la mort du docteur et de deux autres personnes à bord.[21]
J’attends. Une bonne sœur s’approche enfin en claquant ses mains pour dire « jeune homme c’est à vous ! » je suis mort de trouille et j’espère encore tout arrêter : je dis que je n’ai plus mal est ce qu’on peut remettre, je n’ai peut-être rien ?
Le chirurgien dit que ça l’étonnerait vu la température que j’ai : « patience ! On va le savoir tout de suite ! »

Je suis attaché à la table d’opération et on approche le masque : « on va t’endormir à l’éther, comme les soldats des tranchées de 14-18, tu es content ? » Il n’y a plus de chloroforme je me serai bien passé de ça. Les soldats étaient courageux, pas moi.
On me demande de compter, compter m’épuise comme un travail de force mais je sens bien que je n’arrive pas à partir, « augmentez, il est long », je frotte le bout de mes doigts ensembles : tant que je sens quelque chose je suis encore là.
Je me répète que je ne mourrai pas, que je dois revoir mon père. Je l’appelle dans un ultime effort. Je sens la table tanguer sous moi. Des bruits assourdissants que je ne connais pas. Des lumières aveuglantes.
Je me réveille en chambre. J’ai mal. J’ai une vessie de glace posée sur le ventre et nous sommes six dans la chambre. J’ai été opéré pendant plusieurs heures d’une péritonite par des médecins surchargés transformés en chirurgiens, il me reste neuf agrafes sur le ventre.
Dans la chambre, un jeune maquisard qui s’est tiré une balle dans le pied et des rescapés du bombardement.
Quelques temps plus tard, j’ai la surprise de voir arriver ma mère avec madame Magnan : le pont est réparé et le bus fonctionne et nous nous installons quelques temps chez les Magnan. Trop de bonnes nouvelles en même temps !
LIBÉRATION
Cette fois nous sommes occupés par les troupes de libération ! A une douzaine de kilomètre de la Motte du Caire, à Theize, elles ont aménagé une piste d’aviation légère. J’y vais en visite et j’essaie de parler espéranto avec eux mais ils y sont complètement imperméables. Alors on se parle par gestes.
J’arrive à comprendre qu’ils veulent des tomates et la fois d’après je reviens avec dix kilos de tomates. Il en aurait fallu beaucoup plus car ces soldats en ont assez de manger des conserves. Je rentre avec des choses rares et sans prix ici : café soluble, chewing gomme, savon parfumé, lampes de poche et piles électriques, du chocolat et des bonbons acidulés.
Ma mère a fini mon trousseau par le marquage de mon matricule sur mes affaires, elle n’a pas trouvé de numéro 365 en mercerie, il y a huit cent élèves en internat, alors elle a cousu ensemble des trois et des soixante-cinq. Cela lui a fait deux fois plus de travail.

Mais avant mon départ elle fait une rechute et est hospitalisée à dignes pour y être opérée. Je suis fatigué et lassé par toutes ces épreuves. A la radio passe Tristesse de Chopin, c’est la première fois que je l’entends. Cette musique me suit encore et me bouleverse toujours.
C’est le premier octobre 1944 et je dois rejoindre Grenoble pour entrer au collège. Je descends en bus à Sisteron mais je décide de ne pas prendre le chemin de fer pour économiser l’argent du billet et en garder pour mes besoins à Grenoble.
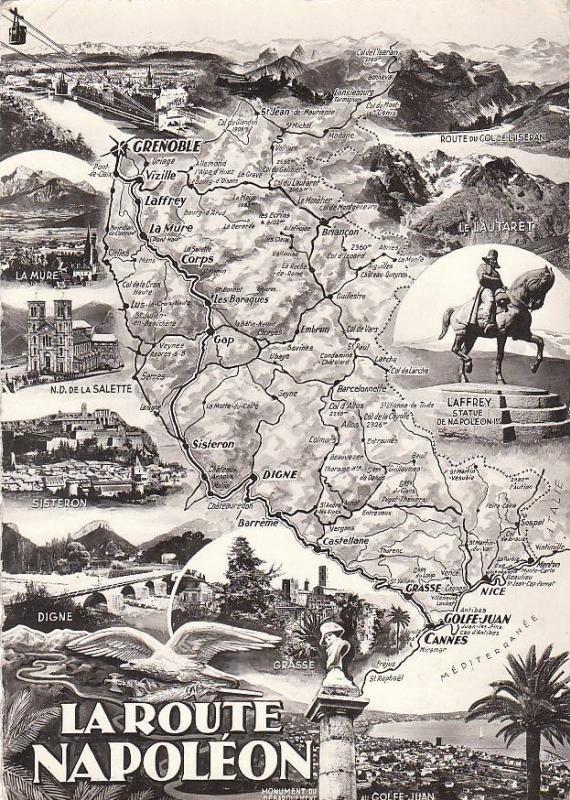
A Sisteron passe la route Napoléon qui remonte les Alpes, les armées de libérations passent aussi par là, je vais tenter ma chance. Je me place au bord de la route avec les deux valises qui nous ont accompagné ma mère et moi dans nos pérégrinations. J’ai aussi un sac à dos et un petit cabas de victuailles. Des canadiens français sont là qui me demandent le motif de mon voyage. Je tends ma notification d’entrée au collège Vaucanson au chef de convoi. Il hésite, vérifie la date et part en discuter avec ses collègues.

Finalement je monte dans sa jeep, je suis bien content. Après bien des méandres et des frayeurs dans les virages de la route Napoléon, nous arrivons à huit kilomètres de Grenoble, à Pont de Claix et je quitte le convoi pour continuer en tram. Au moment des adieux, les chauffeurs des G.M.C, ces gros camions américains, viennent me voir en riant avec une musette de l’armée du soldat en campagne.
LA VIE EN PENSION


J’arrive à Grenoble et je vais directement à la croix rouge : là une assistante sociale me prends chez elle pour la nuit. Elle s’appelle madame Gagnepain, elle a trois jeunes enfants et son mari est comme mon père prisonnier de guerre.
Le lendemain elle m’accompagne au collège Vaucanson en tram. Heureusement qu’elle est là pour me piloter dans cette ville inconnue. Elle me laisse dans les mains des surveillants qui réceptionnent les élèves en me disant qu’elle viendra me voir mais elle n’est jamais venue.
Mon guide s’appelle Courcheski, c’est marqué sur son badge. Il a une bonne tête et il m’inspire confiance. Il me demande où sont mes parents : je dis qu’ils vont venir, je ne mens pas vraiment, je sais qu’ils viendront un jour. Monsieur Courchevski me dit de dire la vérité : c’est sûr, il est polonais ! Du coup je lui raconte ma situation.

C’est un pion, c’est à dire un ancien élève de l’école qui est maintenant à l’institut polytechnique. Les pions sont de familles modestes et en échange de leur travail de surveillance d’étude et de dortoirs, ils sont logés gratis. Nous montons au dortoir, au troisième étage y déposer mes bagages. C’est une grande salle d’un seul tenant où les lits sont alignés en quatre rangées. Elle doit faire vingt mètres de large sur quatre-vingt de long. Mon lit est en tête de la première rangée, à côté du paravent qui cache le lit du pion. Au pied du lit une plaque métallique porte mon matricule : numéro 365.
Monsieur Vigouroux, le directeur, me convoque : il n’a pas vu mes parents et mon cas l’intrigue : il m’invite à venir directement le voir en cas de difficulté. Je m’intègre peu à peu à l’établissement : je regarde pour comprendre. Ici tout marche au coup de sifflet.
Sept heures, sortie du lit immédiate. Le lit doit être complètement ouvert. Attendre au pied du lit le passage du pion de service. Puis en rang pour aller faire pipi. Ensuite direction les lavabos où nous avons chacun un petit coffre mural fermé d’un cadenas. Dix minutes maximum pour la toilette et retour au pied du lit.
Inspection des oreilles. Passage au vestiaire pour échanger pyjamas contre vêtements du jour. Passage au « ciroir » pour échanger pantoufles contre chaussure. Descente au réfectoire, sur les tables, cinq bols d’orge perlée cuite à l’eau plus une tasse de lait chaud et un morceau de sucre : c’est le rationnement. J’accepte d’être chef de table : je dois veiller à la bonne entente des affamés. Je connais en effet à nouveau les affres de la faim : les rations des repas sont réduites à la portion congrue et il n’y a pas de goûter à quatre heures !

ALEXANDRE PREMIER
Je suis chargé de partager tous les aliments ronds qui arrivent sur la table : camembert, omelette de poudre d’œuf, flans… Pour réussir un partage équitable, je fabrique un gabarit d’angle en carton ! Parmi mes camarades, un seul n’a pas l’air de m’aimer et cherche à me vexer. Je lui demande pourquoi : il déteste les rouquins ! Je suis blond…
A chaque fin de semaine les fils des campagnes rentrent chez eux et reviennent repus, chargés de valises pleines de victuailles dont il ils abandonnent le surplus à leurs camarades avant de repartir, selon les affinités.
En classe j’arrive à suivre sans peine, grâce à l’enseignement que m’a donné monsieur Hillaire : mon surnom c’est Alexandre premier. Comme je fais toujours mes devoirs immédiatement et que certains attendent le dernier moment, il m’arrive d’échanger mes brouillons contre des vivres.
Un de ces amateurs n’a même pas pris la peine de recopier et s’est contenté de mettre son nom en tête de la copie. La supercherie est découverte. Le copieur passe immédiatement en conseil de discipline. Il est exclu temporairement et un blâme est adressé à ses parents. Je n’avais jamais pensé aux conséquences disciplinaires de mon trafic : j’ai très peur. C’est long d’attendre une sanction.
Les sanctions les plus bénignes sont ici la consignation le dimanche et le régime des punis qui consiste à assurer un service de parloir le dimanche matin. Le punis attend à la conciergerie et cours chercher les élèves qui ont de la visite pendant que le concierge chronomètre : l’école est très grande.

On les appelle les chameaux coureurs et le concierge décide en fonction du temps obtenu de la reconduction ou non de la punition. La punition se transforme en footing encadré l’après midi jusqu’à Pont de Claix et retour soit seize kilomètres : c’est très dur pour ceux qui n’ont pas de bonnes chaussures.
Certains pions font cracher tripes et boyaux aux punis, d’autres sont plus coulants et les font monter dans le tram ! Ils vont parfois jusqu’à payer le ticket à ceux qui n’ont pas d’argent en leur recommandant la discrétion bien sûr. Mais je ne suis pas inquiété ni puni et je ne saurai jamais pourquoi…
MONSIEUR GRAVIER
Ma mère est entrée en contact avec des thionvillois résidant à Grenoble par l’intermédiaire d’un journal de lorrains en exil.

Ces gens se sont proposés pour être mes correspondants en ville. Je les attends avec impatience car j’ai appris qu’ils roulent en Peugeot 202. Finalement, ils ne se manifestent pas avant Noël et ce jour là, juste avant mon départ à la Motte du Caire, à table, je me jette sur les pâtes à en avoir une indigestion. Résultat, le lendemain, à l’heure où j’aurai du prendre mon train, je suis encore couché à l’infirmerie de l’école : plus de retour à la maison pour Noël. En plus, ces gens ne viennent plus me chercher pour les fins de semaines, les dimanches sont désespérants.
Alors je finis par demander à faire partie du régime des punis. Ça arrange tout le monde finalement, car ça résout du même coup le problème de ma garde. Donc je suis de parloir tous les dimanches et je vois revenir les mêmes correspondants. L’un d’eux, je sais son nom, monsieur Gravier, veut savoir pourquoi je suis toujours puni. Je lui résume ma situation d’exilé et de fils de prisonnier de guerre. Il veut m’emmener tout de suite avec son protégé mais le concierge s’y oppose : il me faudra d’abord une autorisation signée de mes parents. Ce qui est fait.
Le jour dit, je suis mon correspondant jusqu’à « A la croix de lorraine » l’hôtel café restaurant des Gravier. J’attends assis à une table du café, plutôt intimidé par madame Gravier qui m’a accueilli avec une certaine réserve. Puis je m’enhardis et je la rejoins dans la cuisine pour lui proposer mon aide. Travailler ensemble nous permet de faire très vite connaissance : « Elle est rompue la glace ! » comme disait la chanson.

Je comprends ses réticences : son mari lui ramène trop souvent des miséreux esseulés, des p’tits boulots en rupture tombés bien bas qui ont besoin de manger et de s’abriter. Le soir, madame Gravier m’a préparé des vivres à emporter. Le premier protégé de Monsieur Gravier a quitté l’école et mon correspondant viendra chaque dimanche, ponctuel, pour me chercher au collège.
J’apprends l’ajustage de précision sur métaux. Il faut un pied à coulisse et comme je n’en ai pas, j’emprunte celui des autres contre de menus services de finitions de leurs exercices en traits croisés. C’est madame Gravier qui va me faire la surprise : elle m’offre un Roche au 50ième. C’est un bijou dans son étui de moleskine noire et il est gravé à mon nom. Peu de mes camarades en ont un semblable.
ambiance d'époque par les actualités de Vichy, le régime pro-allemand. (images INA)
LE RETOUR DU PRISONNIER
Ce n’est ni un dimanche ni un jour de visite. Pourtant un élève de section commerciale vient me chercher en plein cours : « ton père est là !» Je lui demande comment il est : « incroyable à quel point vous vous ressemblez !» je cours plus vite que jamais rejoindre mon père. Derrière moi j’entends mon camarade distancé crier : « demande au concierge d’avoir l’obligeance d’arrêter le chrono quand tu arriveras toi ! » on peut l’espérer…

C’est la fin de 1944, Grenoble[22] a té libérée le 22 août par les forces françaises libres et les américains ensuite, mon père, lui, vient de rentrer de captivité. Il est là dans le parloir austère et sombre qui m’attend. Je suis presque aussi grand que lui maintenant. Il a toujours été grand pour moi et je me demande s’il n’a pas rapetissé. Nous prenons le temps de nous évaluer à la lueur vacillante de la bougie, je suis encore tout essoufflé de ma course. J’ai d’ailleurs un point de côté. Nous nous étreignons enfin. Je lui demande pourquoi il porte une tenue de l’armée américaine alors que la guerre est finie pour lui. On a rien trouvé d’autre à lui donner et il me montre l’autorisation spéciale qu’il a pour porter ces vêtements.


Nous nous asseyons à la table de visite mais nous n’arrivons pas à dire un mot. Je regarde mon père la gorge serrée. Dans une tentative de rompre le silence, il me vouvoie avant de se taire encore. Petit, quand ma mère me vouvoyait c’était pour me réprimander ou bien pour dire quelque chose d’important. Mais mon père ne me vouvoyait jamais, il avait d’autres moyens pour se faire entendre.
J’ai peur d’être maladroit. Je n’ose pas parler. Alors je prends mon beau stylo Waterman à plume en or et réserve d’encre que j’ai eu pour le certif et je commence à écrire sur une page que je détache du cahier des visites.
« Papa, la guerre nous a joué un mauvais tour. Nous continuons à en souffrir. Les autres font la fête et s’amusent pour fêter la victoire. Je sais qu’un jour nous serons à nouveau réunis tous les trois dans un domicile bien à nous, comme avant. Je te promets que là plus rien n’arrivera à nous séparer. »
Je pousse la feuille vers lui pour l’inciter à écrire. Il ne peut pas, ses mains tremblent trop. Il va à la fenêtre pour masquer son émotion et il fait des commentaires de circonstance sur la neige qui tombe en abondance. Je sais qu’il cache ses larmes. Moi, je pleure. Il se retourne et cherche nerveusement une cigarette. Un signe discret pour lui dire qu’il ne peut pas fumer ici. Il me demande si je mange bien au réfectoire et me tend un billet au hasard. Pauvre Papa, il ne sait pas à quel point l’argent a perdu sa valeur et combien ce qui est écrit sur les billets est illusoire.
Il veut me donner ses tickets d’alimentation et me dit que ça ne le privera pas, qu’il n’a plus jamais faim, lui. Je le rassure en lui racontant les visites chez les Gravier tous les dimanches et le sac de vivre que je ramène pour la semaine. Au moment des adieux, complètement désemparés, nous en oublions de nous souhaiter la nouvelle année qui arrive, il me dit qu’il sera heureux de remercier les Graviers pour toutes les bontés qu’ils ont eu pour moi.
Mon père est à bout de force, il rejoint l’hôpital militaire de Marseille où il se remet. Ma mère aussi est hospitalisée à Marseille. Ils sont vraiment en mauvaise santé. Ce n’est qu’à la fin de 1945 qu’ils pourront quitter leur hôpital respectif. Ils rentrent à Thionville où nous n’avons plus rien.

Mes parents savent combien la vie va être rude. Les Gravier proposent de s’occuper de moi jusqu’à la fin de l’année scolaire et plus si nécessaire. Il leur en coûte et à moi aussi mais mes parents acceptent. J’ai quinze ans maintenant et je vais seul à la Croix de Lorraine. Je dois emprunter le chemin le plus court, respecter les horaires prescrits, consigner mes sorties sur la main-courante de la conciergerie.
BALLE PERDUE
Vers la fin de 1944, beaucoup d’armes circulent parmi nous. Elles proviennent de parachutages alliés destinés aux maquis, de récupération après la déroute des soldats allemands. Mais elles proviennent surtout des greniers de nos vieilles maisons qui recèlent beaucoup des trésors d’avant guerre. Je dégotte moi-même un petit révolver du siècle précédent, il est toujours en état de marche et j’espère qu’il sera mon passeport pour le maquis de Bayons.
Je garde ce secret pour moi, je ne montre jamais l’arme et je ne la transporte jamais. Pour rien au monde je ne prendrais le risque de l’introduire au collège Vaucanson.

Ce serait trop bête de me faire renvoyer après les efforts que j’ai fait ici.
Mais il en va autrement pour mes camarades externes. Plusieurs d’entre eux exhibent des révolvers pendant la récréation. Je m’éloigne d’eux immédiatement.
Dans une salle de classe un garçon manipule son révolver. Par mégarde l’arme lui échappe et tombe au sol. Le coup part. La balle ricoche sur le pied en fonte d’un pupitre et tue un des garçons présent autour de lui. La balle lui a arraché une partie de la tête.
Nous sommes immédiatement renvoyés dans nos dortoirs où nous devons attendre, consignés au pied de nos lits avec interdiction d’en bouger sans être accompagnés.
Nous avons interdiction de parler entre nous. Le temps est bien long et quand l'un d'entre nous a envie de faire pipi il doit attendre qu'on l’emmène. Un détachement de police investit le collège : nos affaires sont soumises à une fouille minutieuse pendant de longues heures et chacun d’entre nous est interrogé individuellement.
ENTREZ DANS LA DANSE

Heureusement, pour nous soutenir pendant l’enquête, les élèves de polytechnique qui nous encadrent habituellement sont là. Je les connais bien car je suis passionné d’électricité et j’ai pris l’habitude de les fréquenter pour développer mes connaissances en électromagnétisme et en propagation hertzienne, les bases de la diffusion radio.
Grâce à eux je me sens capable de m’attaquer au poste à galène que m’a donné Gabriel. Je demande à ma mère de me l'expédier. A la Motte du Caire, je m'isolais dans les toilettes extérieures sur le balcon de la maison pour essayer d’entendre quelque chose sur mon poste : malgré tout le temps passé enfermé, je n’avais pas obtenu de résultats.
Dès que ma mère me fait parvenir la radio par la poste, je m’empresse de relier la prise de terre du poste au radiateur de chauffage central et le fil d’antenne à mon lit métallique. Miracle ! Mon poste à galène me parle pour la première fois ! J’avais des doutes mais il y a de la vie en lui.
Le casque est celui que m’avait donné Gabriel, avec son inscription « propriété insaisissable de la compagnie du téléphone », il est lourd et massif et m’irrite les oreilles. Pour supporter les longues heures d’écoute, je passe d’une oreille à l’autre.
J’en parle bien sûr à table avec les Gravier et le samedi suivant en passant à table, j'ai la joie de découvrir un casque à côté de mon assiette. Il est flambant neuf. Madame Gravier prétend qu’un client de l’hôtel l’a laissé pour moi en quittant sa chambre ... Elle veut sans doute ménager ma fierté et ne pas me donner l’impression d’être couvert de cadeaux.

Mon voisin de lit, Pierre Rambaud hérite du casque lourd auquel je bricole une prise supplémentaire sur la radio. J’écoute radio Grenoble, les émissions ne commencent qu’à six heures du matin. Je suis éveillé bien avant. On entend d’abord une longue modulation continue en U. C’est désagréable mais juste après, démarre la ritournelle habituelle, « nous n’irons plus au bois, les lauriers sont coupés | bip| nous n’irons plus au bois, les lauriers sont coupés |bip| » jusqu’à six heures trente où éclate la Marseillaise à plein volume.
La fin de la guerre est officiellement annoncée le 8 mai 1945 à 15h00. Au collège, la vie continue imperturbable comme d'habitude. C'est sans compter sur les filles en pension de la ville! Elles sont déchainées et viennent jusqu'au collège forcer notre porte! Dans la bousculade, une d'entre-elles gifle le surveillant général. Le directeur préfère se cacher pour ne pas avoir à se fâcher tout rouge! Les filles nous entrainent dans les rues de Grenoble dans l'allégresse générale. C'est si bon la liberté.
C'est l'euphorie : musique! Pétards! Feux d'artifices et de Bengale! Marchands de frites et saucisses grillées!
La discipline en prend un sacré coup et je réalise qu'il était temps: c'est vrai nous avons quatorze ans passés et ce que nous avons vu ces cinq dernières années nous a muri. Nous ne sommes plus les enfants timorés d'avant.
D'ailleurs, à partir de ce jour mémorable, nous sommes autorisés à sortir librement en ville aux heures autorisées toutefois.
Petit bonjour matinal et premières nouvelles du monde. Ensemble, Pierre et moi, nous entendons les nouvelles les plus formidables de l’époque, la mort d’Hitler, la capitulation de l’Allemagne, l’exécution de Mussolini, la découverte de l’horreur des camps de concentration mais aussi le massacre d’Oradour sur Glanne, le retour des prisonniers, la mort du président Roosevelt ... La guerre n'est pas tout à fait finie. Les américains font exploser la bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945 et sur Nagasaki le 9 août. Les japonais capitulent le 2 septembre 1945
Le 25 juillet 1946, les essais atomique des îles Bikini dans le Pacifique, font beaucoup parler dans le dortoir. Nous attendons l’explosion minute après minute et nous retenons notre souffle : on dit que la réaction en chaine pourrait détruire la planète. Nous entrons dans un autre monde.
LA SÉPARATION

C’est les dernières vacances scolaires que je passe à Grenoble. J’ai encore le temps de donner un coup de main aux Graviers qui déménagent et reprennent un autre établissement, le Renaudin, en plein centre ville.
C’est le mois de juin 1946 et je dois décider si je reste plus longtemps ou si je rentre à Thionville. Nous faisons semblant de rien mais nous sommes brisés de chagrin, je le sais. Nous n’osons même pas parler de cette séparation qui vient. Je promets d’écrire.
J’avais imaginé le jour du retour comme un jour de joie. Je n’ai jamais été aussi triste. Je sais pourtant qu’une bicyclette neuve m’attend à Thionville au titre des dommages de guerre pour celle que j’ai perdu au maquis du Tramalao.
Les souvenirs de ces six ans reviennent en masse : ces maquisards assassinés, je les connaissais tous, je voulais faire partie d’eux. Je revois Yvonne Kaiser, sa mère emprisonnée à la citadelle de Sisteron.
Mais ces souvenirs ne retiennent pas mon attention, je ne fais que penser à monsieur et madame Gravier. Je regrette déjà leur affection et leur stabilité solide, sans peur du lendemain. Yvette Gravier m'a acheté des vêtements neufs à ma nouvelle taille. Elle plaisante en retenant ses larmes, "tu penseras à moi tant qu'ils ne seront pas usés".
Je me force à penser aux retrouvailles avec mes parents, je ne suis plus sûr de mon choix. J’ai l’impression de ne plus être intime avec eux. J’ai été si longtemps séparé d’eux. Ce train qui m’éloigne des Gravier m’agace avec son luxe. Les sièges ne sont plus en bois. Ce train est trop confortable en regard de ma peine. Ce train de la rupture est trop rapide. Il n’y a plus d’arrêt jusqu’à Lyon.
Je n’arrive pas à distinguer le nom des gares traversées, je regarde les autres voyageurs sans les voir. Ils sont nuls pour moi. Je me demande le pourquoi de tout cela. Quelque chose en moi est définitivement brisé. Je capitule, mon esprit vagabonde, je confonds les époques je mélange mes parents avec les Gravier, je m’endors.

Aussitôt arrivé, je commence une correspondance postale avec monsieur Gravier.
ÉTERNEL RETOUR

Personne n'est là pour m'accueillir, je l'ai fait exprès. Je laisse mes valises à la consigne de la gare et je vais à la maison à pied. Il n'y a plus de tram, il est cassé par la guerre. Le pont sur la Moselle est flanqué d'un passage en bois. Je reconnais la ville comme si je ne l'avais jamais quitté. J'ouvre grands les yeux pour faire le point. L'immeuble à l'angle de la rue de Villars est au sol. Les deux grandes vitrines de l'épicerie sont remplacées par des vitres à treillis de petits carreaux. Je suis arrivé.
Mes parents me font visiter l'appartement qui est vide de tout ce que nous possédions avant guerre. Place de la Liberté, la ville a entreposé des meubles provenant de logements abandonnés par les allemands qui ont quitté Thionville encore une fois.
Mais mes parents sont arrivés un peu tard après la curée pour récupérer quelques uns de leurs meubles. D'autres réfugiés comme nous qui nous feront visiter leur appartement, sont mieux pourvus en meubles que jadis. Mon père a reconnu une armoire, une table de nuit et un lit, c'est tous ce qu'il pourra sauver. Il manque des lattes au lit et l'armoire a séjourné longtemps sous les intempéries: elle est bien abîmée. Le marbre de la table de nuit est fracassé.
Mes parents dorment dans des petits lits métalliques que mon père a rapproché . Il y en a un dans ma chambre également récupéré des hôpitaux avec une armoire au miroir tout piqué, abandonné par les fuyards et pour lequel il faudra payer un vil prix également. Cet hiver, il fera froid car ils ont emporté aussi tous les appareils de chauffage.
Nous mangeons assis sur les caisses de livraisons consignées. Ma mère fait la cuisine sur un réchaud à gaz à même le sol. Le lustre du plafond est remplacés par une ampoule. Je dois cacher ma peine et ma déception et échapper à cette misère : je cherche partout le triporteur du magasin pour aller chercher mes bagages mais il a été emporté comme le reste. J’emprunte le chariot lorrain [23] des nouveaux voisins pour aller récupérer mes affaires.
C'est que je suis chargé: en plus des deux valises qui nous ont suivi partout ma mère et moi, avec dans leur couvercle des étiquettes d'identité en cas de malheur, il y a une grande malle de corsaire qui vient directement des greniers de la Motte du Caire. J'y ai entassé mes documents d'école, mes petits vêtements du temps de la pénurie dont je n'ai pu me séparer et le poste à galène de Gabriel que j'aurai du laisser à mon copain de chambrée Pierre Rambaud, surnommé Pic Fraise comme si son nez était si pointu... Il devra faire sans la radio.

Les jours passent et j’aide ma mère à l’épicerie. Une cliente se plaint de son poste radio qui ne marche plus. « Amenez-le voir, je verrais ce que je peux faire ». Je m’improvise réparateur amateur. Il faut dire que ce que j’ai appris à Grenoble et un peu d’astuce font merveille.
Les collaborateurs font profil bas: après avoir menacé de revenir avec le fürher à leur tête, il tentent de se justifier en disant, " On ne pouvait donc bien pas..." une expression qui doit venir directement de l'autre côté de la frontière.
Les allemands ont laissé derrière eux un petit poste construit comme la Volkswagen sur le principe d’un poste pour tout le monde. Il est portable et compact mais difficile à régler pour obtenir la bonne station, les gens s’en débarrassent facilement et j’en ramasse parfois abandonnés au sommet d’une poubelle.
C’est tout ce dont j’ai besoin pour bricoler. Il faut bien comprendre que depuis fin de la guerre, il n’y a rien. Rien à acheter sinon très cher quand on le trouve. Alors un poste radio… J’ajoute une lampe au modèle allemand, je réduis sa taille : en fait, je me débrouille et avec du vieux je fais du presque neuf. Les gens prennent l’habitude de venir au magasin faire réparer leur poste et cela durera jusqu’à mon service militaire qui arrivera à point nommé car ces messieurs des impôts commenceront à s’intéresser à ma petite activité.


Je vais saluer monsieur Willy. Nous sommes contents de nous revoir après toutes ces années et aussi complètement détachés du souvenir d’une passade amicale. Monsieur Willy m’invite à entrer et me présente sa famille : il s’est remarié et a deux beaux enfants. Il a un cadeau à me faire : il a fait spécialement pour moi une très belle petite table de salon en chêne. En 1940, nous étions tous les deux privés d’affection, je n’étais pas très éveillé aux choses de la vie et monsieur Willy avait su se contenir pour ne m’aimer que chastement.
Moi, je n'aurais pas d'enfants c'est décidé, ce sera ma vengeance. Mon père se force à plaisanter: "moi j'ai bien regretté en quarante, de t'avoir fait!" Il ajoute que lui et ma mère ne pourront plus me donner de petit frère. Tout ça est bien dommage mais je ne reviendrai pas sur ma décision: comme un prêtre, j'en ai fait le serment.

L'hiver de 1947 est particulièrement froid, la Moselle charrie des blocs de glace: le 30 décembre elle sort de son lit à cause du dégel et envahit les rues du centre. Avenue Albert 1er,chaque cave se remplit au passage par le soupirail et le niveau de l'eau monte inexorablement .
Nous habitons au dessus du magasin, l'appartement est pratiquement vide depuis notre retour et nous décidons de sauver le stock.Il n'y a plus d'électricité,nous disposons des bougies le long de l'escalier pour déménager l'épicerie toute la nuit. Au matin, nous tombons de fatigue sur nos lits, tout habillés. Un kayac circule au milieu de l'avenue. La tristesse de mes parents fait peine à voir: pourtant nous avons Venise sous les yeux quand tant de gens paient si cher pour y aller.

Il n'y a plus de gaz. Mon père et moi montons un bidon de 50 litres d'alcool à brûler pour alimenter le réchaud que j'ai bricolé avec une boite de conserve et le réchaud à gaz. Épuisés et en sueur, nous nous regardons, hagards et puis nous éclatons de rire: nous en avons vu bien d'autre, au diable cette épreuve! J'ai du plaisir à trimer avec mon père, lui aussi. " Ça va bien les jumeaux!" appelle ma mère attirée par notre fou rire. C'est comme ça qu'elle nous appelle maintenant: ses deux "Dédé" se ressemblent tellement comme elle dit et les clients s'en amusent aussi d'autant plus qu'elle nous achète les même pullovers. Justement, les clients cognent au rez de chaussée: ils n'ont plus rien à manger. Nous servons à travers la fenêtre. Dehors des hauts-parleurs rassurent la population et un camion citerne livre de l'eau potable...
Quand l'eau se retire enfin, il faut nettoyer le désastre et recommencer, recommencer toujours comme depuis 40 . Les animaux morts dans les champs sont en pleine décomposition, nous allons être vaccinés à cause des risques d'épidémies, la même piqure qu'en 40 mais cette fois pas chacun de son côté, non, ensembles, mon père et moi.
TÊTE DURE
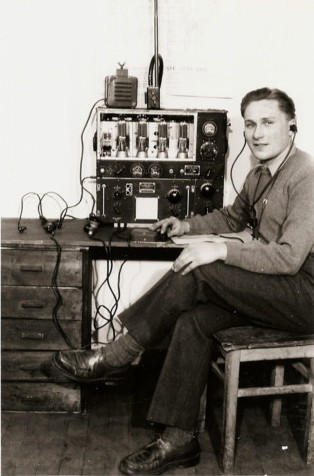
Je fais mon service dans les troupes d’occupation en Allemagne. Ma dernière lettre à monsieur Gravier lui dit bien que ma solde est doublée par ce que je suis en Allemagne, que je ne manque absolument de rien, que j’ai pris du galon et que j’ai une chambre de sous-off, que la nourriture au mess est de qualité et que quand je sors en ville, je mange allemand. Mais ça n’empêche pas monsieur Gravier de m’envoyer un mandat chaque mois. Le geste me fait plaisir, il me dit que c’est pareil pour lui.
J’aurai tellement aimé le revoir, monsieur Gravier. Mais il meurt en 1950 : la permission que je demande pour assister à ses obsèques m’est refusée. « Lien de parenté insuffisant. » Le chef de corps n’est pas méchant homme mais s’il savait à quel point le motif invoqué me brise le cœur.
Mon temps de service change avec les évènements mondiaux: je me tape six mois en plus à cause de la guerre qui vient de commencer en Indochine! Mes dix huit mois faits, je rentre à la maison le jour de mon anniversaire, j'ai vingt deux ans. Je raconte l'Allemagne et ma passion pour le moteur Lohman. Les allemands sont assez fortiches pour développer en période de pénurie, un moteur diesel pour cycle de dix huit centimètres-cubes: il a les même performances que nos mobylettes de cinquante centimètres-cubes! Bref! je n'ai pas pu me le payer...
Mon père fait un petit sourire en coin et m'invite à jeter un œil dans la réserve.

Là, je trouve une Gima[24] , une moto si exceptionnelle qu'on n'en voit pas encore dans la rue! Elle est pour moi. Je suis bouleversé, comment mes parents ont-ils pu l'acheter sinon en se privant de tout. Et pourtant mon père n'a pas hésité.
C'est le mois d'août 1952, je roule ma superbe moto rue de Verdun, la route n'est pas large, la grande brasserie de la Boule d'or empiète largement sur la voie et en face de moi, un camion double le tramway qui roule sur l'autre voie. Je n'ai qu'une seconde pour choisir entre les grandes roues du camion et le tram, le choc est inévitable.
Vlan! Je prends en pleine tête la rampe d'accès au tram. Quand la police arrive au magasin, elle dit que c'est grave, je n'avais pas de casque. Et en plus le fils Chenchen vient de s'éclater la tête en percutant à moto lui aussi la barrière du passage à niveau de la route de Metz. Mais ma mère est forte, comme d'habitude. Heureusement, il n'y a pas de clients à ce moment là! Elle envoie mon père à l'hôpital en prenant le temps de lui dire que si je suis mort, elle ne veut pas me voir.
Mon père me trouve conscient, ce qui est bon signe. On vient de passer un linguet flexible par le trou de ma blessure pour sonder la plaie et voir si je n'ai pas de fracture: il parait que ça ne se voit pas toujours très bien à la radio: ça fourrage dans tous les sens... Pauvre Papa apeuré, il attend que je lui parle enfin: "même pas mal" je joue pour le rassurer. J'en rajoute en parlant de ma tête dure et qu'il sait bien que je suis une forte tête...." Oui... ça c'était avant la guerre, quand tu étais petit, ce n'est plus vrai maintenant..."
Au magasin ma mère met son point d'honneur à continuer à servir les clientes qui ne savent rien encore mais le lendemain, elles ont lu le journal et déboulent avec des mines contrites et des airs compatissants... Pour couper court aux commentaires, ma mère prétend, tout sourire, que je me repose en haut dans mon lit et que je suis trop courbatu pour venir les saluer. Même pas vrai sauf que quand je rentre enfin de l'hôpital, courbatu, je le suis et pas qu'un peu...
LES VRAIES RETROUVAILLES
Mon père ne me quitte plus. Au lieu d'aider ma mère au magasin, il reste à mon chevet. J'ai besoin de lui, il m'aide en soutenant le poids de ma tête pour que je puisse sortir du lit. Nous sommes bien ensembles.
Il me raconte le stalag et la dureté de la captivité. Il se rappelle la libération du camp par les soldats russes. Le camp d'Altengrabow était juste situé dans la région de l'Elbe où les armées soviétiques se sont arrêtées dans leur marche vers l'ouest. Ils arrivent mitraillettes à la main et n'ont qu'une question:" Pétine ou Técole?" Ils savent qu'il y a deux sortes de français et que le pays a été coupé en deux entre les tenants du maréchal Pétain qui a soutenu l'effort de guerre allemand et les résistants avec le général De Gaulle. Il vaut mieux répondre De Gaulle si on ne veut pas être fusillé sur place... Ces jeunes russes excités ne font pas de quartier. Les allemands terrorisés, savent bien ce qui les attend, on dit que les pharmacies délivrent du poison gratuitement aux civils allemands et ils préfèrent se jeter dans les bras des américains.
Nous rions aussi beaucoup de quand j'étais petit. Bien avant 1939 mon père était déclarant en douane chez Vagner Klein, la plus grande entreprise de déménagement de Thionville spécialisée dans l'international. Il fréquente la salle des ventes des saisies et abandons en douane où des enchères ont lieu tous les six mois. Il a tout son temps pour repérer les affaires intéressantes et se renseigner.

Il connait bien les réactions de acheteurs et lorsqu'il a jeté son dévolu sur un objet il a une méthode imparable: il fait d'emblée une offre importante et les autres sont tout de suite découragés! C'est comme ça qu'il a acquis les bijoux que ma mère coudra dans la doublure de nos vêtements avant l'exode.
C'est aussi là qu'il trouvera une magnifique trottinette qui a fait mon bonheur quand j'avais huit ans. C'était une Saroléa, une marque belge, assurance de qualité et même pas importée en France, une rareté.
C'est la rougeole qui m'avait valu ce cadeau magique et cette trottinette, que je devais laisser derrière moi en 1940, était l'objet de beaucoup de convoitises.
Mon père me confisque la trottinette de temps en temps mais là, c'est ma tante Olga qui intervient: " Édouard! rends lui sa trottinette". Il faut dire qu'elle m'adore ( nous avons grandi ensemble et elle n'a pas encore d'enfant ). " Tu ne vois pas comme il est malheureux? Tu veux le rendre malade! Je vais lui en acheter une moi!" .
Ma tante tient en face de chez nous une station service au 22 avenue Albert 1er, l'essence est plus chère au Luxembourg ces années là et les luxembourgeois s'arrêtent volontiers au 22 avant de quitter la ville. Mais si c'est une clientèle assurée, ma tante, en tant que gérante, n'a pas le droit d'encaisser de pourboire, une plaque émaillée est là pour le rappeler au mur de la station.

Mais moi le dimanche, rien ne m'empêche de donner un coup de main et je mets ma belle casquette blanche, en faction sur le trottoir, avec un bon sourire et un bonjour pour tout le monde comme ma mère me l'a enseigné au magasin. Les luxembourgeois se délestent de leur petite monnaie, des pièces trouées et même des pièces jaunes que je glisse dans mon portemonnaie de ceinture.
Outre mes copines qui jusqu'à aujourd'hui encore, me reprochent de ne leur avoir jamais prêtée à l'époque (mais si!), la Saroléa servait de prétexte à tous les racontars: les clientes de ma mère étaient excédées par l'envie de leur enfants, trottinette par ci trottinette par là, elles rapportaient tout ce que je faisais en dehors du magasin !
On m'a vu en centre ville avec ma trottinette alors que ça m'est défendu, le tram y a déjà blessé un enfant, on m'a vu avec mon petit cousin à la fête foraine et sur tel et tel manège à dépenser mes pourboires...
Ma mère est vexée de devoir entendre ces rapportages mais commerce oblige, elle fait bonne figure. Après, c'est mon tour et je ris de ses colères en disant: " mer agitée, force cinq!".
Elle me menace de la pension à la rentrée, elle prépare ma valise en me demandant exprès ce qu'elle doit mettre dedans... Moi, ça ne me touche pas, je sais quelle n'aura jamais le courage et puis la rentrée, c'est loin...
Un soir, à table, je me rends odieux pour essayer de sortir mes parents de leur léthargie: ils travaillent tous deux douze heures par jours et le le soir, ils mangent en silence. Excédé, mon père me gifle : c'est la première fois qu'il me frappe. Le lendemain j'ai un coquard à l'œil. A la maitresse j'ai menti car j'avais honte de lui dire mais ma tante, ni une ni deux, traverse la rue et j'entends encore Olga :" on va le prendre chez nous, Nous... on le battra pas!"
Du coup, je monte dans ma chambre et en redescends avec pyjama et édredon. Là, mon père se fâche vraiment" écoutez moi bien tous les deux: si vous faites ça!... ça sera pour toujours: plus question de mettre un pied ici!"
Il n'en faut pas plus pour me ramener à de plus justes sentiments, je pleure au cou de mon père en protestant de mon amour pour lui et je lui promets d'être sage mais qu'il sera toujours mon Papa.
Quand les allemands sont arrivés, ils ont enlevé toutes les indications en français et je les vois encore démonter les panneaux de la station service de ma tante: "les voleurs ! ils vont prendre ma plaque des pourboires!" " tiens toi tranquille me dit ma mère, on a déjà assez d'histoires comme ça avec la Gestapo". Eh bien cette plaque, ce soir là, je l'ai récupérée et, pour ne pas traverser la rue avec, je l'ai cachée dans un réduit, sous l'escalier dans la station et à mon retour d'exil, en 1946, elle m'attendait encore là où je l'avais cachée. Je l'ai encore et je ne peux m'empêcher de regarder encore les traces qu'elle a laissé dans le mur, au numéro 22 quand je passe sur le trottoir....
Pour mon père et moi, ces souvenirs, tout ça est déjà loin, emporté par la guerre. Mais nous sommes enfin réunis, tous les trois comme avant.
LA VIE ADULTE
En 1954 je possède ma première voiture, c’est une Dyna Panhard et j’en suis très fier. La chance fait que je trouve un garage à louer juste en face de l'épicerie, dans un immeuble qui appartient à une vieille dame de bonne famille. Elle me demande quel genre de voiture je vais acheter car la l'entrée de l'immeuble est très juste et elle craint par dessus tout qu'on abime sa porte en bois. Je la rassure en lui disant que c'est une 5 chevaux mais c'est quand même une voiture de standing et elle est de bonne taille...
Aussi chaque fois que je passe l'entrée, je la sens qui me surveille de la fenêtre qui surplombe le trottoir. Je fais donc bien attention mais un jour c'est mon père qui a le malheur d'érafler la porte en passant! Il vient se garer le long de l'épicerie mais déjà la vieille dame est sur son dos: elle a ouvert sa fenêtre et crie sur mon père à travers la rue.
Je connais mon père, il n'aime rien moins qu'être ainsi montré du doigt devant tout le monde. Il sort de la voiture et traverse la rue... Quand il revient au magasin, nous sommes aux aguets mais il a l'air tout détendu. Je lui demande ce qui s'est passé :" Rien. Je lui ai juste dit qu'elle ne devait pas s'étonner d'être restée vieille fille toutes ces années: c'est parce qu'elle n'avait pas voulu laisser les hommes s'approcher de sa p'tite porte!" dans le magasin, tout le monde éclate de rire.

Avec ma Dyna, je descends à Grenoble voir Yvette Gravier. Nous évoquons le passé depuis notre première rencontre et nous allons nous recueillir sur la tombe de son mari. Je sais pour toujours où elle se trouve. Yvette décède le trois mars 1970. Sa sœur a sans doute préféré me prévenir tard, elle connaît ma sensibilité et mon attachement. Je n’assiste donc pas aux obsèques, décidément… en revanche, je vais chaque année me recueillir sur leur tombe, celle de la « Famille Gravier » : quelle famille si ce n’est moi ? J’ai aimé ce couple autant que mes parents. J’ai aujourd’hui quatre vingt un ans, j’ai conservé pieusement le pied à coulisse gravé à mon nom comme la petite machine singer qu’un antiquaire a déjà essayé de m’acheter sans succès : je ne la vendrai jamais car elle représente trop de souvenirs pour moi.
Monsieur Willy était né comme mon père en 1906. Lui aussi nous a quitté pour toujours.
De monsieur Willy me reste un document dans lequel il atteste le pillage de nos biens par les allemands perpétrés avant l’inventaire officiel de saisie. La petite table en chêne est toujours là. Je la regarde avec un sentiment sans reproche.
J’ai aussi le blanc-seing qui autorisait mon père à porter des vêtements militaires américains, j’ai aussi une de ces chemises en lin écru du siècle passé et les habits que ma mère y a découpé pour moi. J'ai toujours les quatre gros volumes du Larousse que ma mère avait été chercher à Lyon. Et même la facture de 1800 francs du vélo du facteur Massot.

Il faudra que j'attende la mort de mes parents en 1965 pour ma mère et en 67 pour mon père pour découvrir un agenda où ma mère a consigné les horaires de train pour Rambervillers en 1940.
Je pardonne à mes parents mais j'ai bien peur qu'ils m'aient laissé raconter passionnément une belle histoire[25] enjolivée que ma mère avait inventé pour me consoler de ne pas être du voyage vers mon père prisonnier.
Elle avait du cacher soigneusement sa bicyclette car c'est vrai qu'elle avait quand même l'air drôlement fraîche et reposée après son voyage de 140 km à bicyclette !
Je ne saurai donc jamais l'exacte vérité et je continue à croire cette histoire qui m'avait tant remué.
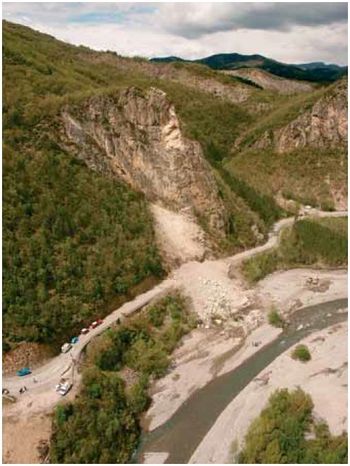
A la fin de la vie de mon père, j'ai lui ai acheté une Renault16 pour que nous retournions ensemble à Milly-la-Martine où il avait survécu enfant à l'exil en travaillant comme un homme pendant la première guerre mondiale. Je ne lui ai pas assez dit combien je l'aimais. C'est sans lui que je suis allé revoir la menuiserie où il s'échinait à fabriquer des bondes pour tonneaux en bois entre huit et dix ans. J'ai retrouvé la bâtisse à l'abandon sur ses indications et jusqu'à l'emplacement exact où il travaillait: comme il me l'avait décrit j'ai trouvé la chute d'eau au fond de l'atelier, la vanne qu'il manipulait pour ouvrir l'eau et les machines-outils délaissées.
Je vous ai parlé [26] de cette montagne sur la route de Sisteron qui me faisait si peur: quand j'ai quitté le midi de la France en octobre 1944 l'aiguille était toujours là mais elle a fini par tomber sur la route qui passe en contrebas, le 7 mai 2004 à cinq heures du matin, en emportant une partie de la montagne mais sans faire de victimes heureusement : la route a été coupée pendant deux semaines . Cela avait pris soixante ans mais je n'étais pas autrement surpris: il fallait bien que cela arrive un jour ou l'autre.[27]
DES ENFANTS DANS LA GUERRE

Quand il fût temps pour moi de reprendre l'école à la Motte du Caire et que je voyais l'instituteur en cours particuliers, celui-ci me demanda, pour voir, de lui chanter une chanson . Je lui avait chanté l’internationale et le brave homme m'avait bien conseillé de ne plus recommencer même si je trouvais les paroles si belles. Les communistes étaient mal vus à cette époque où les français commençaient à trouver qu'on pouvait cohabiter avec ces allemands et vivre presque comme avant......Mais mon père était originaire de Villerupt, ville ouvrière et il avait toujours été sympathisant communiste et en plus, il sera libéré par des soldats soviétiques : d'ailleurs, à Villerupt, les américains n’avaient pas la cote comme partout ailleurs après guerre : US GO HOME, pouvait–on lire sur les murs de la ville. De Gaulle et les américains y passaient pour des usurpateurs.
Un an après notre expulsion de Thionville, un jeune communiste dont le nom symbolise encore aujourd'hui la résistance aux allemands, était fusillé à Chateaubriand où il avait été désigné comme otage après l'assassinat d'un soldat allemand à Nantes. Son nom est Guy Môquet[28] et je me souviens encore de ce qu'il a représenté à cette époque pour les sympathisants communistes et les français que sa mort était censée effrayer: il était si jeune, dix-sept ans seulement. Guy Môquet a écrit, avant de mourir, une lettre à ses parents qui a fait sa légende[29]. La nouvelle de son exécution avait circulé en France comme une trainée de poudre et avait atteint notre village d'accueil. Son exemple m'avait galvanisé et je réalise encore la chance que j'ai eu quand les allemands sont venus nettoyer le maquis du Bayons, de ne pas avoir été là.
À mon retour en 1946, je suis revenu à Villerupt voir la seule de mes tantes restée sur place, Marthe Narreto. Je m’en souviens bien car Marthe vivait avec son mari Angelo et leur fille à la limite entre Villerupt et Thil et que c’est là que j’ai vu de mes yeux à quoi pouvait ressembler un camp de concentration. On avait entendu parler de ces camps à la toute fin de la guerre et à Thil restaient les traces du seul camp d’extermination par le travail sur le sol français [30].
Les gens d'ici se rappelaient trop bien l'interdiction formelle de nourrir les prisonniers. Les barbelés électrifiés étaient encore là autour de baraques préfabriquées toutes neuves. Cette usine de mort était une des dernières tentatives allemande pour fabriquer les fameux V1 qui auraient du permettre aux nazis de retourner la situation en leur faveur.[31]
Quand je revins quelques années plus tard, il ne restait au milieu des prairies qu’un mémorial autour du four crématoire que je n’avais pas vu la première fois. Ce four provenait des abattoirs de la ville, fabriqué par l'entreprise Muller qui existe toujours et fabrique des incinérateurs. C'est un de mes oncles, Louis Narreto qui a réalisé la maquette du camp qu'on peut voir au mémorial.
La guerre m'a suivi jusqu'à la Sollac où je travaillais au début des années 50: je pense à Roger Godfrin, le plus jeune survivant du massacre d'Oradour sur Glane que j'ai connu quand j'y travaillais. Dès que j'avais su son arrivée, j'avais fondu sur lui pour partager nos expériences. Roger, comme moi à la Motte du Caire, était réfugié dans le sud ouest avec toute sa famille. Le 10 juin 1944, son village, Oradour sur Glane, est cerné par la division das Reich et les gens rassemblés place du champ de foire avant d'être séparés, d'un côté les femmes et les enfants, de l'autre les hommes. Roger se souvient des conseils de sa mère, fuir à la vue d'un uniforme allemand et c'est à cela qu'il doit la vie. Il s'échappe de l'école à temps et réussit à se cacher assez longtemps pour survivre. Les troupes allemandes assassinent 642 civils et incendient le village. Roger a sept ans et demi et il perd toute sa famille ce jour là.[32]
Roger restera marqué par ce qu'il a vécu à Oradour. Il se méfie de tout ce qui porte un uniforme et il écope même de 2000F d'amende en 1981 pour outrage après avoir dit" vous n'avez rien d'autre à faire qu'à ennuyer les gens" à un policier: une honte pour la justice compte tenu de son passé...

Aujourd'hui, j'ai toujours en mémoire ces enfants pris dans la résistance pendant l'attaque du maquis de Tramalao et aux frères Pustel, les trois adolescents fusillés le 20 et le 27 juillet 1944 dans la ferme à côté.
Jacques Perret [33]a écrit dans son livre" Bande à part" une phrase que je veux citer ici:
"tout compte fait, notre commune et tacite raison, c'était de retrouver les vieux sentiers de l'école buissonnière et de s'y payer une bonne partie entre copains. Pour le plaisir de jouer une partie de garçon et si quelques uns devaient y laisser leur peau, les graveurs d'épitaphes ne se tromperaient pas beaucoup en inscrivant pour eux: MORTS AU CHAMP D'HONNEUR ET EN PARTIE DE PLAISIR, coïncidence nullement désobligeante"


Il existe une autre lettre de fusillé toute aussi touchante que celle que Guy Moquet écrivit à ses parents, c'est celle d'Henri Fertet, lui aussi inspiré par l'exemple de Guy Moquet [34]et on peut aussi lire le journal d'un petit garçon en guerre(Jacques Nimier)qui retrace ces années là à Paris[35]